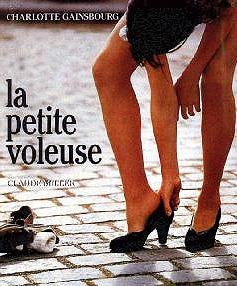Films de l’année 1987:
|
Films de l’année 1988:
|
Films de l’année 1989:
|
* Le
Festin de Babette de Gabriel AXEL, sorti en 1987
avec Stéphane AUDRAN, B FEDERSPIEL, BODIL KJER,
Oscar du film Etranger 1988 , (voir fiche
détaillée)
Babette , cuisinière renommée dans un grand restaurant
parisien, "Le Café Français", fuit la répression de la Commune de Paris en 1871.
Elle trouve refuge au Danemark, dans un petit village, au service d'un pasteur
luthérien.
Tous les ans elle achète un billet de loterie. Quand elle gagne
le gros lot, au bout de quinze ans, au lieu d'améliorer son sort, elle consacre
tout son argent pour reconstituer, en une seule soirée, pour douze couverts, le
faste de la grande cuisine parisienne.
Film tendre, sensible, original et
gastronomique Le menu :
Soupe de tortue
géante
Blinis Demidoff (blinis au caviar)
Cailles en Sarcophage....la
recette complète des Cailles en Sarcophage
Gâteau
aux raisins et figues mûrs | 
|
*
Full Metal Jacket, film anglais de Stanley Kubrick,
sorti en 1987,
scénario de Stanley Kubrick, Michael
Herr, Gustav Hasford, adapté du roman de Gustav Hasford, "The Short-Timers",
durée 116 mn,
avec Matthew Modine ( Guignol), Adam Baldwin (Animal
Mother), Vincent D'Onofrio ( Pyle), R. Lee Ermey ( Sgt. Hartman), Dorian Harewood
(Eightball), Arliss Howard, Kevyn Major (Rafterman) , Ed O'Ross, John Terry, Kieron
Jecchinis, Bruce Boa |
En 1968, en pleine guerre du Viêt-Nam, de jeunes recrues sont accueillies dans
la base d'entraînement des Marines.
Leur instructeur, le sergent Hartman
les forme, en dépassant souvent les limites, de manière à ce qu'ils soient parfaitement
prêts à affronter les difficultés des opérations de combat.
Parmi toutes
ces recrues, un engagé devient le souffre-douleur du sergent instructeur Hartman
: surnommé la "Grosse Baleine", il ne supporte pas les humiliations que lui inflige
son instructeur et, le jour de leur affectation, il se suicide après avoir descendu
Hartman. "Guignol" , qui a assisté au meurtre suivi du suicide, est affecté
dans une unité combattante au Viêt-nam, où il sera employé comme correspondant
de guerre. Il rencontre Rafterman, un jeune américain fougueux qui rêve de voir
des combats et de partir au front.
Guignol est envoyé en reportage au combat,
et Rafterman insiste pour l'accompagner. Sur place, Guignol retrouve Cowboy, un
soldat qui avait fait ses classes avec lui. Les Vietcongs lancent l'offensive
du Têt, surprenant les Américains. La section part "nettoyer" la zone industrielle
de Hué, mais tombe en embuscade, immobilisée par les tirs d'un tireur isolé.
Cowboy est abattu, puis une bonne partie de l'escouade. Guignol tombe nez à nez
avec le sniper et c'est Rafterman qui lui sauve la vie : le sniper était une toute
jeune fille vietnamienne ! Comme presque tous les films de Kubrick, celui-ci
est structuré en trois parties bien marquée: "l'instruction
des Marines", "L'arrivée au Viêt-Nam" et "l'offensive
du Têt" | 

|
Le film a été tourné
entièrement en Angleterre, dans une base militaire et dans une zone industrielle
abandonnée, la végétation tropicale du Viêt-Nam ayant
été restituée par l'importation massive de palmiers vivants
et de plantes artificielles made in Hong-Kong. Émaillés d'incidents
et d'accidents, le tournage dura plus d'un an, certaines scènes, complexes
donnerent lieu à plus de 30 prises.
Pour donner plus de réalisme
au début du film, Kubrick embauche, pour jouer l'instructeur (Sgt Hartman),
Lee Ermey, un ancien Marine, qui était, paraît-il, aussi violent
et ordurier au naturel que dans pour le tournage.
Après les "Sentiers
de la Gloire" et partiellement "Barry
Lyndon" , Kubrick aborde la question de l'homme dans la guerre. Même
s’il ne condamne pas entièrement la guerre, Kubrick la considère comme une machine
à réveiller les instincts de destruction les plus primaires de l’homme. Ainsi,
lorsque le Marine tire sur la Viêt-cong et la neutralise, il se met à adopter
une sorte de gestuelle simiesque pour manifester sa joie, ce qui nous ramène à
l’aube de l’humanité, époque que le cinéaste a déjà explorée, au début
de "2001: L'odyssée de l'espace "
* BAGDAD CAFE ( Out of Rosenheim) de
Percy ADLON, Allemagne, sorti en 1987
Avec
Marianne Sagebrecht, C.C.H. Pounder, Jack Palance, Christine Kaufmann, Monica
Calhoun
 |
Après une scène de ménage, plantée par son mari en plein désert, Jasmin atterrit
au Bagdad Café, motel sale et minable entre Disneyland et Las Vegas. La patronne,
Brenda, Noire tapageuse et insatisfaite, règne sur tout un petit monde de routiers
et de personnages énigmatiques.
Peu à peu, Jasmin se fait apprécier de tous,
nettoie énergiquement, et remet même le café à flot grâce à "Magic", une boite
de magie avec laquelle elle monte des tours assistée de Brenda. Entre les deux
femmes va naître une solide amitié. Un indien, peintre du dimanche va peu à peu
séduire Jasmin lors de séance de poses.
Film complètement décalé
au charme fou, des personnages improbables mais envoûtants: une allemande
perdue dans le désert, avec des indien(ne), des shérifs marginaux,
des routiers, un boomerang et un château d'eau. |
*
L'OURS de Jean-Jacques ANNAUD, sorti
en 1988
| Scénario adapté du livre le "GRIZZLI" de James
Oliver Curwood
avec Tcheky Kario, Jack Wallace, des oursons, un ours kodiak Un
ourson orphelin, inconscient et maladroit est adopte par un gros ours bourru.
Il fera avec lui l'apprentissage de la vie et du mal, un mal que personnifient
deux chasseurs lancés a leurs trousses. Au terme de l'affrontement final,
hommes et animaux sauvages vont se quitter grandis.
Une histoire simple et
belle où l'ours apprend au chasseur la valeur de la vie. |  |
* Une
Affaire de femmes , de Claude Chabrol , sorti en 1988
; durée 105 mn ; scénario et dialogues de Claude Chabrol et Colo
Tavernier O'Hagan, d'après Francis Szpiner sur l'histoire vraie de Marie-Louise
Giraud ;
avec : Isabelle Huppert (Marie Latour),
François Cluzet (Paul Latour), Marie Trintignant (Lulu), Nils Tavernier (Lucien,
l'amant), Dominique Blanc (Catherine)
| Sous l'Occupation, Marie s'improvise faiseuse
d'anges (avorteuse) pour rendre service à ses voisines et aussi pour gagner
un peu d'argent.
Mais la France de Vichy voit ces pratiques illégales d'un
très mauvais œil. Dans la France des hommes vaincus, les femmes mènent
leur propre guerre. Le combat de Marie naît par hasard, quand elle décide d'aider
sa voisine qu'elle trouve plongée dans une bassine de moutarde. Devenue avorteuse,
elle libère ses semblables d'une maternité non désirée et, grâce à l'argent gagné,
s'affranchit d'une certaine servitude conjugale. Elle devient une véritable
femme d'affaires. Désormais, c'est elle qui occupe la place laissée vacante par
Paul, son mari revenu diminué de la guerre. C'est alors que la grande Histoire,
jusqu'alors simple toile de fond, revient au devant de la scène : dénoncée, Marie
se retrouve en prison, avant d'être jugée et condamnée par la France de Pétain
collaborationniste mais intransigeante sur un ordre moral soi-disant restauré. La
révolte du personnage de Marie se renforce dans l'image négative des hommes, soit
collaborateurs sans scrupules, soit anciens soldats humiliés par la défaite. L'amant
qui se pare des attributs d'une virilité caricaturale appartient à la première
catégorie, le mari à la seconde.
La caméra intègre ce dernier avec une lenteur
symbolique, complice de la réticence de son épouse. Le retour de Paul est d'abord
suggéré par l'image de l'équipement militaire dont il s'est dépouillé. Puis il
apparaît allongé sur un lit conjugal dont Marie lui refusera la jouissance. |  |
Ni soldat, ni mari, privé de rôle, Paul
est manifestement de trop. Il obtiendra sa revanche en convertissant ses découpages
inutiles en arme de dénonciation dirigée contre sa femme.
Le sort de Marie
rejoint alors celui de son amie juive Rachel, déportée pour son appartenance raciale.
Au début, Marie chante dans les rues bordées d'affiches pétainistes, indifférente
à la guerre. Pour elle, le bien et le mal n'existent pas. L'argent des avortements
devient un pot de confiture où elle trempe ses doigts en riant comme une enfant.
Il lui permet de quitter les quartiers pauvres et insalubres pour de larges appartements
baignés d'une lumière qui se reflète sur son visage fardé.
Les portes de
l'obscure prison se referment alors avec une brutalité plus cruelle encore sur
cette femme-enfant qui oscille entre naïveté candide et cruelle froideur. Dès
lors, son visage perd ses couleurs pour revêtir la pâleur diaphane des martyrs.
Les hommes, s'emparant de cette affaire de femme, en font une histoire de mort.
*
La petite Voleuse, de Claude Miller, sorti en 1989;
scénario de François Truffaut , Luc
Béraud, Annie Miller, Claude Miller, Claude de Givray; avec Charlotte Gainsbourg
(Janine Castang), Didier Bezace (Michel Davenne), Simon de La Brosse (Raoul) Clotilde
de Bayser (Severine Longuet), Raoul Billerey, Chantal Banlier, Nathalie Cardone,
Renée Faure, Catherine Arditi.
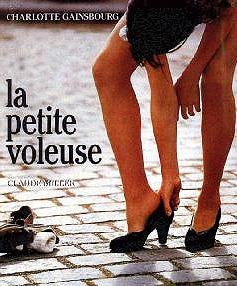 |
Dans une petite ville du centre de la France vers 1955, Janine, seize ans,
vit une existence morne en province. C'est une enfant adoptée.
Pour
s'évader, elle va au cinéma et charparde de-ci de-là. Employée chez un couple
bourgeois, elle rencontre Michel, un homme marié, mais il la trouve trop jeune. Janine
en sortant de l'école vole un paquet de cigarettes dans une voiture de l'armée
américaine et un vêtement aux "folies de Paris". Le directeur de cet établissement
arrive chez ses parents adoptifs et découvre le butin. Un jour, Janine rencontre
Raoul, jeune couvreur, en train de voler. La complicité, puis l'amour va lier
ces deux jeunes gens en rebellion contre leur monde. Janine est le pendant
féminin de l'Antoine Doinel des 400 Coups,
dans une histoire que Truffaut n'a pas eu le temps de réaliser. On retrouve
les thèmes des parents absents, de la passion pour le cinéma, des
jeunes années difficiles. |
Charlotte
Gainsbourg déclare : " C'est sur ce film que, pour la première fois, j'ai
eu conscience qu'il y avait un vrai travail à faire si l'on voulait être acteur.
Avant j'obéissais, ou je faisais plaisir, mais l'envie ne venait pas de moi..
Pour ce film, j'ai eu l'impression que Claude m'emmenait là où il voulait, sans
que je m'en rende compte. Il m'a fait travailler presque malgré moi. Les scènes
où je prenais le plus de plaisir (et c'est encore vrai aujourd'hui) étaient les
scènes de violence, parce que, là, tu te défoules et tu t'oublies."
* Les
Liaisons dangereuses, de Stephen Frears, sorti en 1988 aux USA et 1989 en France;
scénario de Christopher Hampton, adapté du roman éponyme de Laclos, musique
originale : George Fenton, photographie : Philippe Rousselot , montage : Mick
Audsley , durée : 119 minutes; avec Glenn Close ( Marquise de Merteuil ), John
Malkovich ( Vicomte de Valmont ), Michelle Pfeiffer ( Madame de Tourvel ), Swoosie
Kurtz ( Madame de Volanges ), Keanu Reeves ( Le Chevalier Danceny ), Mildred Natwick
( Madame de Rosemonde ), Uma Thurman ( Cécile de Volanges)
| En France à la fin du XVIIIe siècle. Deux
aristocrates brillants et spirituels, la marquise de Merteuil, exquise et dangereuse
et le séduisant vicomte de Valmont, signent un pacte d'inviolable amitié à la
fin de leur liaison. La marquise de Merteuil propose au vicomte de Valmont, en
vertu de ce pacte, de déflorer la jeune et candide Cécile de Volanges, fraîchement
sortie du couvent et qui doit prochainement épouser son ex-favori, M. de Bastide.
Elle veut ainsi se venger de lui. Désireux de regagner les faveurs de la
marquise, Valmont s'exécute sans difficulté ni plaisir particuliers. Plus ardue
et plus excitante lui paraît être la conquête de la vertueuse Mme de Tourvel,
qui séjourne chez sa tante. Ce film est beaucoup plus fidèle au roman original
que la version précédente Les
Liaisons dangereuses (1959) de Roger Vadim. En 1988, à peu près en même
temps que Milos Forman, Stephen Frears s'attaque à un monument de la littérature
française. Mais là où Forman célèbre la légèreté du libertinage (Valmont), Frears
colle au roman de Laclos, à ses joutes amoureuses, à son machiavélisme et à sa
perversion. | 
|
Le résultat est jubilatoire : Glenn Close et John Malkovitch
sont délicieux de cruauté rentrée. Tout au long du film, leurs dialogues rivalisent
de cynisme et de perfidie. Quant à Michelle Pfeiffer, elle incarne magnifiquement
la prude Mme de Tourvel, incapable de résister à l'embrasement de la passion.
À côté de ce trio de charme, on remarque deux jeunes comédiens quasi débutants
: Keanu Reeves dans le rôle du chevalier Danceny et Uma Thurman (alors âgée de
18 ans) dans celui de Cécile de Volanges. Ces acteurs, tous exceptionnels, servent
un film au raffinement extrême.
Stephen Frears souhaitait
s'inspirer des tableaux de Fragonard. Il a fait appel à des décorateurs et des
costumiers remarquables (récompensés par deux Oscars) et accordé une grande importance
aux détails. Les robes de soie qui se gonflent sur les chaises, les bas blancs
tendus sur les mollets des coureurs de jupons : tout vibre et respire. Le ballet
des accessoires commence dès la première scène, où la marquise de Merteuil et
le vicomte de Valmont s'habillent précautionneusement, comme deux duellistes qui
enfilent leurs tenues de combat. Il s'achève avec la dernière image, où la perfide
envoûteuse se démaquille enfin, vaincue, déchue.
*
La Vie et rien d'autre, de Bertrand
Tavernier, sorti en 1989, scénario de Bertrand Tavernier et Jean Cosmos,
durée 135 mn
avec Philippe
Noiret (Le commandant Dellaplane), Sabine Azéma (Irène),
Pascale Vignal (Alice), Maurice Barrier, François Perrot, Jean-Pol Dubois André,
Michel Duchaussoy.
Novembre 1920. La Première
Guerre Mondiale est achevée depuis deux ans. La France panse ses plaies et se
remet au travail. Dans sa voiture avec chauffeur, Irène, une grande bourgeoise
parisienne part à la recherche de son mari, porté disparu au front, fait le tour
des hôpitaux militaires où sont encore soignés les blessés de guerre.
Sa
route croise une première fois celle du commandant Dellaplane, qui dirige le Bureau
de recherche et d'identification des militaires tués ou disparus, et qui la choque
par son franc-parler. Perrin, un collègue du commandant, est pour sa part chargé
de dénicher la dépouille d'un 'soldat inconnu', qui sera enseveli au pied de l'Arc
de triomphe.
Dellaplane apporte aussi son aide à Alice, une jeune institutrice
qui a perdu son fiancé. Irène, Alice, le commandant se croisent, s'affrontent
et finalement apprennent à se connaître.
Bertrand
Tavernier dénonce l'inhumanité des autorités officielles
qui après avoir pousser les soldats vers la mort pendant la Grande Guerre,
ne pense qu'à utiliser ces morts pour des cérémonies glorieuses
après le conflit. Les situations individuelles et les drames de ceux qui
cherchent à savoir ce que sont devenus leur proches n'intéressent
pas la hiérarchie.
Comme toujours, Tavernier prend le parti de l'humain
en face des institutions.
* QUAND
HARRY RENCONTRE SALLY ( When Harry met Sally) de Rob REINER, sorti en 1989, scénario
de Nora Ephron.
Avec Billy Cristal, Meg Ryan, Carrie Fisher, Bruno Kirby,
Steven Ford, Lisa Jane Persky, Michelle Nicastro
Sally
accompagne Harry en voiture à New-York, juste après la remise de leur diplôme
à l'université de Chicago. Les affinités ne fusent pas entre le jeune homme cynique
à souhait et la jeune femme sophistiquée et un tantinet coincée.
Cinq ans
plus tard, ils se retrouvent par hasard, au grand dam de Sally, côte-à-côte dans
un avion. Bien qu'Harry soit sur le point de se marier, son regard acide quant
aux relations hommes-femmes est resté intact tandis que Sally se dit vivre une
grande histoire d'amour.
Cinq autres années passent et enfin, Harry rencontre
vraiment Sally.
Un de ces films inexplicablement réussi et où
flotte un charme certain. L'évolution lente entre un un homme et une femme
des sentiments depuis l'hostilité vers l'indifférence, le détachement
et enfin l'amour.
Avec, en prime, le plus célèbre orgasme simulé
du cinéma, dans un restaurant, pour prouver que les filles savent faire
semblant!
* Jésus
de Montréal, un film québécois de Denys Arcand, sorti en
1989 ; durée 119 mn ; avec Lothaire Bluteau ( Daniel), Catherine
Wilkening ( Mireille), Johanne-Marie Tremblay ( Constance ), Rémy Girard ( Martin
), Robert Lepage ( René ), Gilles Pelletier ( Fr. Leclerc ), Yves Jacques ( Richard
Cardinal )
Un jeune comédien, de retour d'un long
voyage et chômeur, accepte l'invitation du curé du "sanctuaire" (on
ne dit pas «l'oratoire», mais on montre celui du Mont-Royal) de moderniser , de
rafraîchir le chemin de la croix que l'on joue chaque été dans les jardins. Pour
lui, manifestement, ce n'est pas du tout affaire de foi, mais simplement une occasion
d'exercer son métier de comédien, donc de communicateur. Consciencieux, il se
met d'abord à l'étude du personnage Jésus, puis il compose son texte, recrute
quatre collègues et joue la pièce.
Elle a beaucoup de succès et on en parle
dans les médias. Mais la modernisation est poussée trop loin et les autorités
du sanctuaire interdisent la représentation. Voulant la jouer une dernière fois,
les comédiens bravent l'interdiction, mais peu avant la fin, un imposant service
d'ordre vient tout arrêter. Il y a bousculades avec la foule, et Daniel-Jésus
tombe avec sa croix par-dessus, subissant un choc crânien qui provoque sa mort.
Voir fiche
détaillée du film sur Ciné-Passion.
* Le
Temps des Gitans (Dom za vesanje) d' Emir Kusturica , film (Yu GB, It) sorti en
1989, durée 142 mn ; musique de Goran Bregovic; avec Davor Dujmovic
(Perhan) Bora Todorovic (Ahmed), Elvira Sali (Danira), Ljubica Adzovic (la grand-mère)
| Perhan, fils bâtard d'un soldat slovène
et d'une tzigane, vit dans un taudis de la banlieue de Skopje, en Macédoine, avec
une grand-mère un peu sorcière, qui l'adore, sa soeur infirme et son oncle Merdzan,
joueur et cavaleur invétéré.
Son seul ami est un dindon apprivoisé. Dans
la communauté des manouches, il n'a aucun avenir. il part pour l'Italie, sur les
conseils d'un truand, Ahmed Dzida, qui gagne sa vie en faisant du trafic d'enfants.
Perhan rentrera au pays fortune faite. mais ses rêves de bonheur se heurtent
à la dure réalité : sa soeur, qu'il croyait en sécurité à l'hôpital, a été enlevée
pour être prostituée et la jeune femme qu'il épouse meurt en couches. Ahmed et
ses frères l'ont trompé sur toute la ligne.
Il se
vengera grâce à ses dons de télékinésie, avant d'être abattu sauvagement. C'est
en lisant un article traitant du trafic d'enfants orchestré par les gitans qu'Emir
Kusturica eut l'idée de faire un film sur le sujet.
D'abord désireux de réaliser
un documentaire, il décida rapidement de voir plus haut avec un long-métrage.
Bénéficiant d'un solide budget, il débuta un tournage qui allait s'étaler sur
neuf mois à travers la quasi-totalité des républiques yougoslaves. Le
Temps des gitans est une grandiose évocation de la diaspora des romani, où se
télescopent avec bonheur revendication sociale et esprit d'enfance, tragédie et
folklore, réalisme et féerie. Toute la détresse du monde y est convertie en idéalisme
fervent. C'est la continuation, dans un registre
plus grave et une forme plus élaborée, du film de son compatriote Aleksander Petrovic:
J'ai même rencontré des tziganes heureux
(1967). |  |
Papa est en voyage d'affaires (1985),
avait attiré l'attention sur le Bosniaque Emir Kusturica et lui avait valu la
consécration du festival de Cannes.
Le
Temps des gitans a reçu le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1989.
Une
version longue du Temps des gitans est sortie sous la forme d'une série de six
épisodes diffusée à la télévision yougoslave
La suite, à partir de 1990