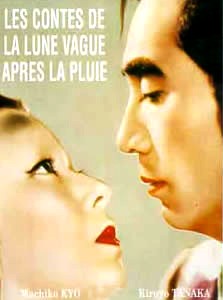* Les Vitelloni de Federico Fellini,
sorti en 1952 (titre français alternatif:Les Inutiles); scénario
de Fellini, Morise et Barjaval; musique de Nino Rota, durée 105 mn, Noir
et blanc;
avec : Leonora Ruffo, Franco Interlinghi, Paolo Borboni, Cl Farell,
A Sauvage, F Fabrizi, A Sordi.
Fausto est le chef incontesté d'un
groupe de célibataires oisifs. Il est contraint d'épouser la jeune
Sandra qu'il a séduite et mis dans une situation intéressante...
C'est la sœur de son ami Moraldo.
Fausto s'habitue difficilement à
sa nouvelle condition d'homme marié et de vendeur dans un magasin d'objets
de piété qu'il a été contraint d'accepter pour subvenir
aux besoins de sa famille. Il continue cependant de rêver d'aventures amoureuses,
au grand désespoir de femme.
Sa galanterie finit par lui faire perdre
son emploi et Sandra apprenant ainsi son infidélité quitte le domicile
conjugal en compagnie de leur enfant.
Fausto réalise alors tous ses
torts et retrouve Fausta chez son père. Celui-ci fait la morale à
Fausto qui cherche à se faire pardonner. Sandra accepte ses excuses et
tout s'arrange.
Ce scénario assez conformiste vaut par la poésie
de Fellini et par sa franchise dans sa description du groupe d'hommes qui entoure
Fausto. Fellini se pose non pas en accusateur mais en témoin compréhensif.
La présence physique des personnages s'efface devant la description méticuleuse
du ressort moral qui les habite.
Comme dans ses autres films, Fellini utilise
des personnages parfois déconcertants pour donner un tour un peu baroque
à ses descriptions de leurs caractères. Il allie avec bonheur le
réalisme cru de la vie observée avec minutie et un onirisme exaltant.
Malgré leur attitude considérée comme asociale, les figures
les plus marquantes des Vitteloni restent profondément attachants.
*
Le salaire de la peur de Henri-Georges
Clouzot, sorti en 1953, d'après le roman homonyme de Georges Arnaud,
durée 141 mn, Grand Prix du Festival de Cannes
1953 ; Ours d'Or de Berlin en 1953
avec
: Yves Montand (Mario), Charles Vanel (M.Jo), Peter Van Eyck (Bimba), Folco Lulli
(Luigi), Jo Dest (Smerloff), Véra Clouzot (Linda), Dario Moreno (Hernandez), Pat
Hurst, Miss Darling, William Tubbs, Gromoff, Rico Zermeno.
Au Guatemala, dans un village écrasé de chaleur,
des hommes venus de tous les coins du monde végètent dans l'espoir de trouver
l'occasion de se refaire une existence. Ils se retrouvent au bar d'Hernandez,
qui partage avec Mario le Corse les faveurs de la servante métisse Linda.
Un jour, une occasion se présente : A cinq cents kilomètres de là, un puits de
pétrole, propriété d'une compagnie américaine, a pris feu. Pour éteindre le gigantesque
brasier, à l'aide du souffle de nitroglycérine, il faut la transporter sur les
lieux du sinistre. Une forte prime est offerte aux chauffeurs pour conduire les
deux camions transportant cette dangereuse charge susceptible de sauter à tout
instant sous l'effet de la chaleur ou d'un choc un peu important.
Deux équipages,
de deux hommes chacun, sont engagés pour cette périlleuse aventure: Luigi, l'Italien
et Bimba un nordique d'une part et deux Français, Mario et Jo, vieux cheval de
retour qui domine son compatriote, d'autre part. Toutes les chances au départ
semblent reposer sur la personnalité de Jo, aventurier par vocation. Pourtant,
devant ce danger nouveau, il est le premier à s'effondrer. |  |
L'admiration qu'éprouvait Mario pour son coéquipier se transforme alors
en mépris. Le premier camion, conduit par Luigi, se volatilise dans une explosion.
Restent Mario et Jo, mais ce dernier, terrassé par la peur, n'est plus que l'ombre
de lui-même et Mario s'affirme comme chef de l'expédition et n'hésite pas à sacrifier
Jo.
Il réussit l'exploit de livrer l'explosif, mais meurt dans un accident
à son retour, alors qu'il se croyait vainqueur et que sa vigilance était relâchée.
Clouzot signe un film haletant, jouant en permanence sur les nerfs des
spectateurs par une mise en scène intense, malgré la longueur du film. C'est aussi
une vision très pessimiste de l'humanité, ce qui avait commencé, chez lui, avec
"Le Corbeau" (1943). Aucun des personnages ne trouve finalement grâce à ses yeux.
* Les Contes de la lune vague après
la pluie (Ugetsu monogatari) , de Kenji Mizoguchi, sorti en 1953,
scénario de Matsutarô Kawaguchi ,Yoshikata Yoda et Akinari Ueda (roman) ; durée
94 mn;
Lion d'Or du festival de Venise 1951
avec Masayuki Mori ( Genjurô), Machiko Kyô ( Mme Wakasa ), Kinuyo Tanaka ( Miyagi
), Eitarô Ozawa ( Tôbei), Ikio Sawamura ( Genichi ), Mitsuko Mito ( Ohama )
| Le film se passe à la fin du XVIe
siècle; à cette époque, le Japon est déchiré par les guerres intérieures.
Dans la région d'Omi, sur les bords du lac Biwa, un potier, Genjuro, vit
pauvrement, sous la menace des hordes de l'armée Shibata. Ce soir-là, la fournée
a été bonne; il décide d'aller à la ville, en compagnie de son beau-frère, Tobei
vendre le produit de son artisanat.
Miyagi, son épouse, restée seule avec
son fils, doit faire face aux mercenaires : elle est tuée d'un coup de lance,
mais l'enfant est indemne. Pendant ce temps, les hommes tirent un bon prix des
poteries. Tobei va pouvoir réaliser son rêve : acheter une coûteuse armure de
samouraï, au désespoir de sa femme, Ohama, qui tente de le raisonner et le perd
dans la foule.
Tandis qu'il joue les foudres de guerre, elle tombe entre
les mains de soudards. Quant à Genjuro, il est la proie d'un autre maléfice. Une
séduisante princesse, Wakasa, l'entraîne dans sa luxueuse résidence, à l'écart
de la cité, et le subjugue par ses charmes.
Il goûte des joies édéniques,
avant de réaliser qu'il a été le jouet d'une illusion.
La riche demeure où
il croit avoir été reçu est en ruine depuis des années: Wakasa était un fantôme.
Un prêtre rompt le sortilège, mais le potier se retrouve finalement dépouillé
de son bien. Il rentre tristement au village, où il trouve sa femme qui l'attend
et lui pardonne.
Son fils le rejoint et se couche à ses côtés. Au réveil,
il s'apercevra que ce bonheur retrouvé aussi est un leurre : Miyagi est morte,
son fils fleurit pieusement sa tombe. Genjuro continuera à actionner le tour,
tandis que Tobei, lui aussi de retour au pays, ayant récupéré Ohama dans un bouge,
jette à la rivière ses armes de samouraï, symbole de toutes les vanités. | 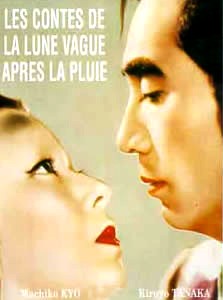 |
Ce film est d'un raffinement extrême, à la beauté tour à tour altière
et éthérée, conjuguant en un même mouvement l'épopée et l'élégie, l'art de la
fresque et l'art de la fugue.
Les Contes de la lune vague peut être regardé
comme un point limite de l'art de l'écran, qui transcende le clivage des genres,
des lieux, des époques, et touche d'emblée à l'universel.
Et pourtant, dans
son pays d'origine, le film ne fut qu'un demi-succès. Son réalisateur lui-même
s'en déclarait insatisfait. Quand il le tourne, Kenji Mizoguchi (1898-1956) a
déja plus de soixante-dix films à son actif, dont une infime partie a été
vue en Europe.
* Voyage
à Tokyo (Tokyo monogatari) , un film japonais de Yasujiro Ozu, sorti en
1953, scénario de Kôgo Noda
Yasujiro Ozu; musique de Kojun Saitô ;
durée 136 mn;
avec Chishu Ryu ( Shukishi Hirayama), Chieko Higashiyama
( Tomi Hirayama ), Setsuko Hara ( Noriko ), Haruko Sugimura ( Shige Kaneko), Sô
Yamamura ), Kuniko Miyake ( Fumiko ), Kyôko Kagawa ( Kyoko)
| Un couple de retraités
se sent vieillir.
Un matin de juillet, ils décident de quitter leur petit
village portuaire et de rendre visite à leurs enfants, établis à Tokyo. Mais ceux-ci
les reçoivent plutôt froidement. Seule la veuve de leur second fils, tué à la
guerre, Noriko, leur témoigne un peu d'amitié.
Un soir, l'homme retrouve
un de ses camarades et se saoule au saké. Puis les deux vieillards regagnent leur
village. Dans le train du retour, la femme est prise d'un malaise.
Elle mourra
sans avoir pu revoir les siens, prévenus trop tard. Les funérailles terminées,
chacun se hâte de repartir. La plus éprouvée est Noriko, à laquelle le vieil homme,
touché de sa sollicitude, conseille de se remarier.
Le soir tombe et il reste
seul. Ce film comme la plupart des autres raconte une histoire assez pessimiste
et illustre la désagrégation des valeurs familiales et sociales, dans un pays
guetté par la modernisation. Critiqué comme réactionnaire par certains, Ozu est
en fait un contemplatif, inscrivant de menus faits quotidiens dans le grand livre
de l'éternité, et donnant un sens au plus petit détail. Ses films sont d'un réalisme
minutieux qui confine paradoxalement à l'abstraction. |
 |
Yasujiro
Ozu (1903-1963) a été découvert tardivement en Occident. Il fallut l'obstination
de quelques critiques éclairés pour que soit enfin révélée au public l'oeuvre
de ce créateur discret, à l'inspiration résolument traditionaliste, au style d'une
sobriété et d'un dépouillement déconcertants.
Retrouvez la
biographie et la filmographie de Yasujiro Ozu
*
Les Diaboliques de Henri-Georges
Clouzot, sorti en 1955, d'après le roman "Celle qui n'était
plus" de Pierre Boileau et Thomas Narcejac; durée 116 mn, Prix
Louis-Delluc 1954
avec : Simone Signoret (Nicole), Véra Clouzot (Christina),
Paul Meurisse (Michel), Charles Vanel (Fichet), Jean Brochard (Plantiveau), Noël
Roquevert (M.Herboux), Pierre Larquey (M.Drain), Thérèse Dorny (Mme Herboux),
Georges Chamarat (Dr Loisy), Jacques Varennes, Michel
Serrault (M.Raymond), Robert Dalban, Jen Temerson, Yves-Marc Maurin, Georges
Poujouly, et Jean-Philippe Smet.
| |
Michel Delasalle est le directeur d'une pension privée pour jeunes garçons
un peu miteuse. C'est un homme machiavélique et cruel qui règne en despote sur
un corps enseignant plutôt lâche et qui terrorise sa femme Christine, fragile
et cardiaque.
Il ne cache pas sa liaison avec Nicole, une institutrice de
l'établissement, équilibrée et déterminée. Celle-ci est néanmoins victime de la
brutalité de Michel.
Les deux femmes finissent par s'allier, et sous l'impulsion
de Nicole, elles décident de supprimer cet homme odieux. Elles arrivent à le droguer
et à le noyer dans une baignoire à l'extérieur de l'établissement puis à le transporter
dans une malle afin de jeter son corps dans la piscine de la pension qu'il était
sensé ne pas avoir quitté et faire croire de la sorte à un accident. Mais
le cadavre disparaît mystérieusement et d'étranges phénomènes se produisent. Christina
est en proie à la peur et l'état de son cour se détériore de plus en plus. L'angoisse
s'installe à la pension jusqu'au jour où Christina succombe d'une crise cardiaque
pour avoir vu le cadavre de son mari aux yeux révulsés se dresser devant elle
sortant d'une baignoire. La mort de Delessale était feinte et tout le reste une
mise en scène .
Michel et sa complice Nicole ont réussi à mener à bien la
machination ayant conduit à l'élimination de Christina. Mais un policier malin
a deviné les sinistres plans des amants diaboliques et les démasque. Clouzot
a profondément changé le roman de Boileau et Narcejac pour ne garder que l'ambiance
trouble de cette petite pension de famille sordide et étouffante. A sa sortie,
la promotion du film proclamait " Ne révélez pas la fin du film à vos amis ! "
Même si Clouzot se distingue là d'Hitchcock, qui met très vite le spectateur dans
le secret, on peut apprécier la mise en scène et le montage qui font monter l'angoisse
progressivement. |
D'ailleurs Hitchcock avait voulu adapter
à l'écran ce même roman, mais était arrivé trop tard. Il se rattrapera en 1958
avec l'admirable Vertigo adapté du roman
"D'entre les morts" des mêmes Boileau et Narcejac.
Pour
l'anecdote ce film voit la première apparition à l'écran, parmi les élèves, d'un
enfant de 11 ans, Jean-Philippe Smet, l'actuel Jonnhy Hallyday. Autre anecdote,
plus tragique: Vera Clouzot, épouse du réalisateur, qui joue l'épouse
cardiaque, meurt en 1960 d'une crise cardiaque.
*
Nuages flottants ( 浮雲 Ukigumo) de Mikio
Naruse; scénario de Yoko Mizuki d'après un roman de Fumiko Hayashi,
musique Ichiro Saito, photographie Masao Tamai, montage Hideshi Ohi, durée : 2h03,
date de sortie au Japon : 15 janvier 1955;
avec Hideko Takamine (Yukiko Koda),
Masayuki Mori (Kenkichi Tomioka), Chieko Nakakita (Kuniko, femme de Tomioka),
Mariko Okada (Osei), Masayuki Mori (Kengo Tomioka), Isao Yamagata (Sugio Iba),
Chieko Nakakita.
| En 1946, Yukiko Koda, rapatriée d'Indochine, rentre
à Tokyo, où elle retrouve Kenkichi Tomioka, un ingénieur forestier qu'elle avait
connu pendant la guerre, lorsqu'elle avait travaillé à Dalat comme secrétaire
du ministère de l'agriculture. Tomioka avait alors promis de divorcer pour l'épouser.
C'est pourtant Kuniko, la femme de Tomioka, qui ouvre la porte à Yukiko.
Tomioka sort avec elle, et ils vont dans un hôtel pour consommer leur ancienne
passion; mais Tomioka n'est plus décidé à divorcer de sa femme, qui, dit-il, a
trop souffert pendant la guerre. Yukiko lui reproche alors son attitude, et se
met en vain à chercher du travail. Elle va retrouver son ancien beau-frère,
Iba, qui l'avait séduite quand elle était petite, et lui rappelle son attitude.
Cependant Iba s'enrichit rapidement avec divers trafics et accepte d'aider financièrement
Yukiko. N'ayant pas de réponse de Tomioka, Yukiko se met en ménage avec un des
nombreux G.I.s. alors à la recherche d'une aventure locale. Un jour, Tomioka,
dont la situation n'est guère brillante, lui rend visite, et l'emmène dans une
station thermale de montagne. Là, ils sympathisent avec Mukai, un patron de bar,
dont la femme, Osei, beaucoup plus jeune que lui, fait des avances à Tomioka.
De retour à Tokyo, Yukiko, réalisant cette liaison, se sépare de Tomioka,
mais découvre bientôt qu'elle est enceinte de lui. Elle décide de se faire avorter,
mais à l'hôpital, apprend par les journaux, que le patron, ayant découvert la
liaison d'Osei, l'a tuée.
Elle va chez Tomioka, mais surprend une coursière de bar qui semble
être intime avec lui. Dépitée, elle retourne chez son beau-frère, qui
profite de la naïveté des adeptes d'une secte d'adorateurs du soleil
qu'il a créée. Iba prend en charge Yukiko, qui s'occupe des comptes
de la secte.
Tomioka arrive un jour, et lui apprend que sa femme est morte, et qu'il
n'a même pas les moyens de payer son enterrement. Toujours amoureuse
de lui, Yukiko vole l'argent de la secte, et donne rendez-vous à Tomioka
dans son hôtel. Elle le supplie de la laisser le suivre dans une île
perdue du sud de l'archipel (l'île de Yakushima)
où il vient d'être nommé, et il finit par accepter.
Au terme du long voyage, Yukiko tombe malade, et finit par mourir seule
en plein typhon, pendant que Tomioka est parti en expédition. Revenu
trop tard, il la prend dans ses bras et réalise alors la force de son
amour.
|  |
Nuages flottants est l'adaptation de
l'ouvrage Ukigumo, de la romancière japonaise Fumiko Hayashi. Mikio Naruse
entretient une intime relation avec l'auteur, puisqu'il adaptera cinq autres de
ses livres, parmi lesquels Iwashigumo (Nuages d'été, 1958) et Midaregumo (Nuages
épars, 1967).
Le cinéma de guerre ou de combat l'intéresse peu, la tonalité
principale de ses films se rapproche d'avantage du « Shomin géki », c'est-à-dire
un genre qui vise à dépeindre le quotidien du petit peuple.
La guerre 39-45
a également beaucoup marqué le cinéaste qui peint des portraits de familles en
crise, des portraits de femmes formidables, fortes et lucides dans une société
en reconstruction qui panse des plaies. Nuages flottants comporte de nombreuses
descriptions de la misère du Japon des années d'après-guerre,
surtout par contraste avec la période faste où le Japon colonisait
et pillait l'Extrême-orient. (Montre Oméga et bouteille de Cointreau
témoigne de ce passé)
À de nombreuses reprises dans
le film, les deux personnages marchent côte à côte, c'est l'occasion de dialogues
émouvants. Les deux héros font le point sur leur situation, « ensemble
», vraiment. "Je ne crois pas avoir vu un homme et une
femme marcher ainsi dans un film. " (Serge Daney)
Comme très
souvent chez Naruse, le thème central reste la condition féminine. Quel que soit
leur âge, les femmes sont les véritables héroïnes du cinéaste. Même quand
elle vend son corps à un soldat américain, Yukiko reste digne, idéalisée,
dotée de la conscience et de la lucidité les plus aiguës. Les hommes, comme Tomioka,
quant à eux, sont régulièrement décrits comme des lâches, des rustres ou tout
simplement des êtres inadaptés, en quête de repères.
Injustement méconnu
en France, Naruse est pourtant l'auteur de 90 films entre 1930 et 1969 dont certains,
comme ce film, sont de vrais joyaux.