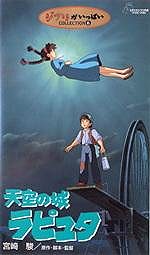Biographie
Hayao Miyazaki est né le 5 janvier 1941 à Tokyo.
Sa jeunesse est marquée
par la Deuxième Guerre Mondiale et par l’image d’une mère atteinte de tuberculose,
qui restera alitée pendant neuf ans. Son père dirige une société qui fabrique
des gouvernails d’avions pour l’armée. Miyazaki a dix-sept ans lorsque sort Le
Serpent blanc, premier dessin animé de long métrage japonais.
Enthousiaste,
il décide aussitôt de devenir dessinateur. Mais, il n’a jamais crayonné que des
avions ou des vaisseaux de guerre et il peine à créer des personnages. Étudiant
dans une faculté d’économie, il rejoint un “groupe de recherche sur la littérature
enfantine”, seule activité qui, à l’époque, s’approche d’un club de bande dessinée.
Miyazaki commence sa carrière en 1963 comme simple animateur au studio Toei douga.
Il participe à de nombreux classiques de l'animation japonaise, notamment Horus,
prince du Soleil.
Il travaille en 1971 chez A Pro avec Isao Takahata puis
chez Nippon Animation en 1973 où il contribue pendant cinq ans à la série des
« World Masterpiece Theater » (Heidi entre autre).
En 1978, il réalise sa
première série télévisée, Conan, le fils du futur.
Cette série lui permet
de commencer à développer ses thèmes favoris. Les deux héros sont souvent considérés
comme des prototypes de Sheeta et Pazu de Le Château dans le ciel (Laputa).
Chez Tokyo Movie Shinsha il réalise, en 1979, son premier film : Lupin III
: Le Château de Cagliostro. Devenu, depuis, un classique, ce film représente une
étape marquante dans la carrière de Miyazaki.
Il participe, en tant que
scénariste et réalisateur, à la série Sherlock Holmes.
Il commence
sa bande dessinée Nausicaä de la vallée du vent en 1982. Grande saga épique et
écologique, il met plus de 10 ans pour la finir.
Avec le succès de l'adaptation
cinématographique de sa bande dessinée Nausicaa, en 1984, il fonde, en compagnie
d'Isao Takahata, le Studio Ghibli. Dans ce studio,
il réalise avec ce dernier de nombreux films à succès. La plupart de ses films
sont mis en musique par Joe Hisaishi.
Ghibli concrétise l'ambition d'amener
l'animation japonaise vers un niveau supérieur de qualité. Ses films sont longs,
souvent complexes et peuvent se voir à plusieurs niveaux. Ils ne sont pas
en général destinés aux très jeunes enfants.
Miyazaki quitte formellement Ghibli le 14 janvier 1998 pour s'occuper d'une nouvelle
structure : Butaya (La maison du cochon), près du studio Ghibli en vue de sa proche
retraite.
Cependant, le 16 janvier 1999, Miyazaki revient au studio Ghibli
en tant que shocho (ce titre signifie approximativement « la tête du service »).
En 2001, Miyazaki termine la réalisation du Voyage de Chihiro et annonce
lors d'une conférence de presse qu'il s'agit de son dernier long métrage, mais
après tout, il avait déclaré de même après Princesse Mononoké.
Fin
2004, Le Château ambulant sort au Japon, il relate l'histoire fantastique
de Sophie dans un monde aussi décalé qu'à son habitude, mais contrairement à ses
précédents films l'histoire n'est pas de lui mais tirée d'un roman de Diana Wynne
Jones.
Hayao Miyazaki est aussi un mangaka, le manga Nausicaä de la
vallée du vent est sorti en 1994 au Japon et a eu un grand succès.
Miyazaki
et le Shintoïsme (d'après Cécile
Mury et François Macé, Télérama)
Le
shintoïsme
est certainement au centre de l'inspiration de Miyazaki
Totoro,
créature sylvestre, n’est pas seulement cet adorable nounours géant dont raffolent
les petits spectateurs d’ici. C’est aussi un « kami
». Dans l’œuvre de Miyazaki, bien des choses restent invisibles pour nos yeux,
mais sont, en revanche, très familières à un public nippon formé au shintoïsme.
Cette religion originelle du Japon, fondée sur l’animisme et le polythéisme, est
un formidable vivier de légendes, de monstres et de merveilles, dans lequel le
réalisateur a puisé sans modération.
Dans le monde du shinto,
chaque chose, chaque être est habité par des puissances spirituelles, des kami,
sortes de divinités petites et grandes.
Et Le Voyage de
Chihiro (2001) nous emmène parmi eux, littéralement : Le titre japonais est
Sen to chihiro no kamikakushi, “Kamikakushi”, qui n’a pas été traduit dans le
titre français, signifie “caché par les dieux” et procède d’une croyance populaire
selon laquelle les personnes disparues seraient passées dans un autre monde.
Ce qui arrive à Chihiro, entrée, au crépuscule, dans d’étranges thermes où affluent
les kami. Ce rassemblement évoque une tradition d’après laquelle, chaque onzième
mois du calendrier lunaire, les kami délaissent le reste du monde pour se retrouver
à Izumo, célèbre sanctuaire. En outre, placer ce rendez-vous dans des thermes
est tout sauf fortuit, puisque le culte des kami commence toujours par un acte
de purification par l’eau.
Normalement, les dieux n’ont pas
de visage, mais ils peuvent se rendre visibles à travers un objet, un animal,
ou même un humain. Dans Le Voyage de Chihiro, ils s’incarnent au gré de la fantaisie
de Miyazaki. Le « dieu putride », par exemple, incroyable tas de boue et de déchets
(y compris un vieux vélo rouillé), se révèle, une fois purifié par les bains,
être le kami d’une rivière, corps de serpent et tête de vieillard. Autre impressionnant
personnage, le sans-visage, ombre noire et face blafarde, suggérée à Miyazaki
par les masques de papier portés lors de certains rituels au sanctuaire shintoïste
de Kasuga. Au cours de son périple spirituel, Chihiro croise aussi un curieux
dieu radis, mi-tubercule, mi-sumo, manière de montrer que chaque chose, même la
plus modeste, possède son kami.
Dans le cinéma de Miyazaki,
il n’y a pas de grands dieux, qui existent pourtant au Japon. Là, au contraire,
ce sont des dieux mineurs, familiers. Chez Miyazaki, le merveilleux s’invite en
effet souvent en voisin. Le réalisateur a d’ailleurs consacré tout un film à cette
magie au quotidien. Mon voisin Totoro (1988), ou la rencontre de deux fillettes,
Mei et Satsuki, avec les kami de la forêt qui jouxte leur maison, trois « totoro
», divinités bienveillantes, dont le sanctuaire est un gigantesque camphrier.
Une « shimenawa
» enserre l’arbre : « Il s’agit d’une corde en paille de riz, qui indique qu’un
espace est consacré. On la place aussi autour d’un terrain pour pacifier la terre
avant de construire une maison. Ou, comme dans Mon voisin Totoro, sur un emplacement
exceptionnel : un arbre extraordinaire, un rocher bizarre. C’est alors le refuge
d’un dieu… »
A ces références, Miyazaki ajoute de nombreux
détails qui enchantent discrètement Mon voisin Totoro. On aperçoit ainsi un temple
dédié à Inari,
un kami très populaire : « Il y en a partout au Japon. Inari est un dieu du riz
et des récoltes. Ses sanctuaires s’ornent souvent de deux renards blancs en porcelaine,
car cet animal est son messager. Le culte se maintient : en plein Tokyo, on trouve
notamment un sanctuaire pour Inari au sommet d’un immeuble. Il était là avant
l’édifice, et on l’a reconstruit dessus. Il y a énormément d’exemples de ce genre…
»
L’autre grande religion du Japon, le bouddhisme,
n’est pas absente : un jour de pluie, Mei et Satsuki s’abritent dans un petit
sanctuaire consacré à Jizo,
protecteur des chemins : « Jizo a eu un succès foudroyant au Japon. Dans le bouddhisme,
on dit qu’il faut choisir la voie dans laquelle on va renaître, et il y a six
possibilités. Jizo joue le rôle d’un guide. A l’entrée des cimetières, on trouve
fréquemment six statues (une par “voie”) le représentant, souvent sous la forme
d’un moinillon. »
On pense à cette séquence où la plus jeune des fillettes
fait halte auprès des fameuses six statues… Symbole d’autant plus fort que Jizo
est aussi le protecteur des jeunes enfants : « Comme il se situe entre la vie
et la mort, il est aussi censé guider les enfants mort-nés. Avec la libéralisation
de l’avortement au Japon, il a suscité un intérêt particulier… »
Autre
référence spirituelle dans Le Voyage de Chihiro : une allusion au taoïsme,
via l’« ommyodo » (« voie du ying et du yang »). En effet, Yubaba, la sorcière
des thermes, envoie sur son ennemi une armada de papiers volants : « C’est une
“technique” d’origine chinoise, développée au Japon à partir de l’Antiquité :
les maîtres du ying et du yang sont censés fabriquer des êtres qui leur obéissent
un peu comme des golems, à partir de n’importe quelle matière. »
Le surnaturel chez Miyazaki se nourrit de syncrétisme religieux, de mythologie
et de références culturelles historiques.
Nausicaä
de la vallée du vent (1984) s’inspire d’une légende du VIe siècle ; Princesse
Mononoke (1997) se situe au XVe. Dans ce superbe conte, les forces magiques de
la forêt sont en guerre contre un clan de forgerons, qui, avec la modernité, leur
apporte la mort. Dieux sangliers, loups et cerf sont de la bataille. « Ce ne sont
pas des animaux innocents. A l’époque où les Japonais étaient de grands chasseurs,
avant l’arrivée du bouddhisme, les gibiers les plus traqués étaient le sanglier
et le cerf. Quant au loup, son nom en japonais, “ookami”, signifie “le grand dieu”.
» « Mononoke » n’est pas non plus un terme innocent : il évoque la force maléfique
d’un être en proie à la rage. Cette rage des dieux, comme celle des humains face
à eux, façonne des héros ambigus. Comme dans le shintoïsme, rien n’est manichéen
dans ces films. Une des raisons pour lesquelles le cinéma de Miyazaki est un monde
à part.
Filmographie
:
En tant qu'animateur
- 1968 : Horus,
prince du Soleil (太陽の王子 ホルスの大冒険,
Taiyo no oji : Horusu no daiboken ) de Isao Takahata
- 1969 : Le chat botté
En tant que réalisateur
En tant que scénariste
- 2010 : Arrietty, le petit monde des chapardeurs de Hiromasa Yonebayashi
- 2011 : La
Colline aux coquelicots ( コクリコ 坂
から, Kokuriko zaka kara )
de Gorô Miyazaki, son fils
Quelques films en détail
| * Le Château
dans le ciel (天空の城ラピュタ
Tenku no shiro Rapyuta), scénario et animation de Hayao Miyazaki
, sorti le 2 août 1986 (Japon) ; durée 124 mn,
musique: Joe Hisaishi Une montgolfière est attaquée
par des pirates. Sheeta, jeune fille prisonnière d'hommes mystérieux, profite
de l'occasion pour tenter de s'échapper et tombe dans le vide.
Le pendentif
qu'elle porte au cou s'illumine soudainement, sa chute est ralentie et elle descend
doucement vers le sol. Pazu, jeune garçon travaillant dans une mine, la voit descendre
en flottant, et la rattrape. Tous deux se lient d'amitié.
Pazu raconte à Sheeta qu'il recherche la légendaire ville flottante Laputa, symbole
d'une civilisation toute-puissante aujourd'hui disparue. Mais les hommes poursuivant
Sheeta ne tardent pas à la retrouver.
Aidée par Pazu, elle va tenter de leur
échapper | 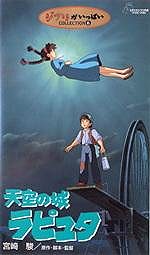 |
 |
Porco Rosso ( 紅の豚 Kurenai
no buta ), scénario et animation de Hayao Miyazaki ;
sortie au Japon en 1992, et en France le 21 Juin 1995, , production du Studio
Ghibli, durée 93 mn; voix française de Jean Reno , Adèle Carasso
, Sophie Deschaumes , Jean-Luc Reichman. En Italie, durant la période
de l'entre-deux-guerres, sur fond de récession économique et de montée du fascisme,
sur une île déserte perdue dans l'Adriatique, un ancien pilote émérite des forces
aériennes italiennes se voit transformé en cochon et reconverti en chasseur de
prime : Porco Rosso.
Dans son hydravion rouge, nombreuses seront les péripéties
: chasse aux pirates de l'air qui ont pris pour habitude de détrousser les touristes
de passage dans la région, sauvetage d'otages, duels aériens, courses d'hydravions,
subterfuges pour semer la police secrète italienne...
La vie du pilote sera
mouvementée et riche en aventures.
Ses soutiens sont principalement de sexe
féminin. Gina, une amie d'enfance qui a été mariée autrefois à d'autres pilotes,
et Fio, une jeune mécanicienne douée en aéronautique. Malgré la légèreté
apparente du film, Porco Rosso est un réquisitoire contre la guerre et ses absurdités. |
* Princesse
Mononoké ( もののけ姫 Mononoke Hime ) , scénario
et animation de Hayao Miyazaki ; sortie au Japon le
12 juillet 1997, et en France le 12 janvier 2000, musique de Joe Hisaishi, production
du Studio Ghibli, durée 135 mn.
| L'histoire se déroule dans le Japon médiéval (ère Muromachi
, XVème siècle). C'est une époque troublée, où le syteme
féodal médieval s'est effondré et où la societé s'est dirigée vers l'ere
moderne. Au Nord de l’Archipel vit une tribu pacifique, les Emishi, dont
le futur chef est le jeune prince Ashitaka. Un sanglier sauvage possédé par une
divinité néfaste attaque son village.
Ashitaka le tue, mais il est blessé
au bras et frappé d’une malédiction qui peut entraîner sa mort.
Sur les conseils
de la grande prêtresse du village, il part vers l’Ouest où il devrait trouver
le moyen de conjurer le maléfice. Au cours de son périple, il rencontre
Jiko, un bonze vénal. Celui-ci lui révèle l’existence d’une forêt où vit un Dieu-cerf,
créature mythique qui règne sur le monde animal et végétal, doté de pouvoirs surnaturels.
Ashitaka arrive au village des Tatara, une communauté de forgerons dirigée d’une
main de fer par Dame Eboshi.
Retranchée dans sa forteresse, celle-ci accueille
les malades, les femmes perdues et les paysans sans terre, qu’elle défend contre
les clans voisins. Mais Dame Eboshi est détestée par San, une jeune fille sauvage
élevée par les loups, qui reproche aux Tatara de détruire la forêt pour alimenter
leur forge et étendre leur domaine.
On la surnomme Princesse Mononoké : “la
princesse des spectres”. Un soir, San s’introduit dans le village pour tuer Dame
Eboshi. Ashitaka s’interpose. Grièvement blessé, il quitte les Tatara pour ramener
la princesse inconsciente au cœur de la forêt. Là, il rencontre enfin le Dieu-cerf.
Un gigantesque combat éclate alors entre les forces en présence. Ashitaka parviendra
à ses fins : faire vivre en paix les hommes, les animaux et les dieux. Comme
a son habitude, Hayao Miyazaki apporte à l'animation et aux décors un soin extreme.
La féérie engendrée par ces décors, l'image et la musique est omniprésente.
Dans ce film, on retrouve l'une des principales préocupation de Hayao Miyazaki
: la défense de la nature, mais aussi la dénonciation de la guerre, l'importance
de la vie, la tolérance. |  |
*
Le Voyage de Chihiro ( 千と千尋の神隠し
Sen to Chihiro no Kamikakushi), scénario et animation de Hayao Miyazaki
, sorti au Japon en juillet 2001 et en France le 10 avril 2002, studio Ghibli;
durée 125 mn , musique de Joe Hisaishi.
 |
Le voyage de Chihiro se déroule dans un univers imaginaire replacé dans le
Japon moderne.
Il nous conte l'histoire de Chihiro, une fillette capricieuse
de 10 ans. Chihiro et ses parents se rendent à leur nouvelle maison. En route
ils s'égarent, et arrivent devant un passage mystérieux. Le traversant, ils se
retrouvent sur des collines près de la côte, et découvrent un parc d'attraction
abandonné.
Poussés par leur faim, les parents de Chihiro s'installent à un
magasin désert mais rempli de victuailles, pendant que celle-ci explore la ville.
La nuit tombe, et petit à petit des esprits envahissent les lieux.
Effrayée,
Chihiro retourne voir ses parents, qui se sont transformés en cochons ! Elle
se retrouve livrée à elle-même dans un monde de dieux, d'esprits et de monstres,
une ville de bains régie par une sorcière. Là, les humains inutiles sont changés
en animaux ou disparaissent.
Pour survivre, Chihiro doit abandonner son nom
et commencer à travailler. Aidée par le mystérieux Haku, elle va devoir travailler
dans le bâtiment des bains pour ne pas être transformée à son tour en cochon.
La description de cet établissement est inspiré par le Dôgo
Onsen de Matsuyama. Ce bâtiment étrange est habité par une multitude d'êtres
fantastiques qui vont tour à tour aider ou empêcher Chihiro à redonner un aspect
humain à ses parents.
Pourra-t-elle un jour revenir dans son propre monde?
Ce film a reçu l'Ours d'or du Meilleur film au festival de Berlin en 2002
et l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003.
Au Japon, il a détrôné Titanic
en tête du classement des meilleures recettes de l'histoire. |
Portail Japon .... . . . . . . . Plus
de cinéma
Des remarques! des questions? Venez
déposer librement vos réactions sur les
pages wikini cinéma de NezumiDumousseau