Les films de l'année 2005
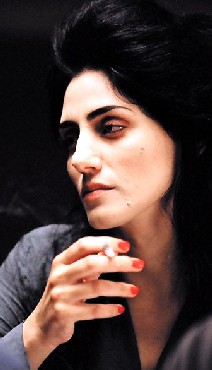
Ronit Elkabetz
|
Les films de l'année 2005
|
|
|||
*
Gabrielle, de Patrice Chéreau, scénario
: Patrice Chéreau, Anne Louise Trividic, d’après l’œuvre de Joseph Conrad ( Le
Retour, publié en 1897) , avec Isabelle Huppert (Gabrielle), Pascal
Greggory (Jean), Thierry Hancisse (le rédacteur en chef), Raina Kabaivanska (
la chanteuse russe); photographie de Eric Gautier ; musique de Fabio Vacchi. Durée
90 mn ; sortie le 28 Septembre 2005.

L'action se situe en 1912, à Paris, dans un appartement au luxe raffiné. Un couple marié depuis dix ans semble équilibré même si figé dans ses rituels. Jean semble heureux, conquérant, certain d'être intelligent, doté d'une autorité naturelle acquise avec l'art de gagner de l'argent. Gabrielle, instruite, perfide, fière d'avoir fui le toit paternel et de faire envie, plane au-dessus des flatteurs et de la maisonnée avec une certaine grâce. Essentiellement soucieux de paraître, d'agrandir le cercle de ses relations, il s'intéresse à la politique, s'adonne à des oeuvres philanthropiques, renfloue un journal à l'agonie. Elle, règne sur ses domestiques et les invités de leurs jeudis mondains, clouant le bec aux pique-assiette et distribuant des sourires ostentatoires.
Ce couple apparemment soudé va se briser à grands fracas. Le premier coup de théâtre arrive sous la forme d'une lettre de rupture, que Jean, pour une fois rentré tôt découvre un soir dans son cabinet de toilette aux marbres blancs. Gabrielle, "la pièce la-plus splendide de sa collection", lui annonce en peu de mots qu'elle est partie, elle a pris un amant, elle clame son désir de respirer ailleurs, de connaître l'authenticité, la chair.
Jean donne alors le spectacle du désarroi et de
la honte, de l'arrogance de l'époux offensé, du mépris, de la froideur opaque.
Il est tour à tour odieux et pitoyable, mais il n'a pas le temps de se ressaisir
car Gabrielle revient.
Il l'aurait préférée morte. Il hurle, il a la loi pour
lui ! Il est prêt à pardonner, à faire le grand seigneur. Mais elle passe
très vite de la contrition au défi. La revenante, effondrée, furtive et blême
comme un fantôme remontant des sous-sols par l'escalier de service, va éclater
de rire lorsque son époux et maître lui distille son pardon.
Gabrielle est l'histoire d'une femme enfermée dans un mausolée par un mari qui la voit en maîtresse de maison, mais qui, écrit Conrad, "pas un instant ne pensa à elle simplement en tant que femme". Il n'y a jamais eu d'intimité entre eux, rien qui ne s'échange ou ne se dise ailleurs que devant les domestiques, les chambrières.
C'est surtout l'histoire d'une revanche. Incapable de mener jusqu'au bout son escapade, elle, qui n'a pas le courage que réclame le grand amour trouve la force et le calme pour transformer sa lâcheté en défi. Elle reste à présent dans le funéraire écrin conjugal, mais en avouant le pire (le nom de l'amant : ce rédacteur en chef "huileux et revanchard" haï par son époux), en lâchant les mots qui blessent : "Vous n'êtes jamais venu à moi... Pourquoi ne m'avez-vous jamais vraiment tuée ?... Si j'avais pensé une seconde que vous m'aimiez, je ne serai pas revenue... L'idée de votre sperme dans mon corps m'est insupportable."
Lui, reste implacable : "Votre souffrance m'apaisera. Chaque jour, le matin, je vérifierai que vous allez mal !" Mais c'est elle qui, à l'issue de ce face-à-face bergmanien , aura le dernier mot. Prenant comme toujours le parti de celui ou de celle qui crée le trouble, Chéreau aura, avant le baisser de rideau social, poussé ses personnages dans un huis clos sexuel pathétique où la victoire de Gabrielle sera totale, définitive mais amère.
Le style de Chèreau reste classique et pour certains un peu froid et distancié. Les premiers plans de Gabrielle rappellent l'émoi provoqué jadis par des images en mouvement. Tout ce qui, au fil du XXe siècle, scanda l'histoire du cinéma est ici réutilisé malicieusement, autant en hommage aux origines qu'en un langage adapté au sujet.
Les prestations de Pascal
Greggory et d'Isabelle Huppert sont irréprochables.
Le jeu d'Huppert évoque son rôle dans La
Pianiste (2001) de Michael Haneke.
Patrice Chéreau en parle
directement: "
Très honnêtement, il y a quelque
chose qui s'est déclenché quand j'ai vu La Pianiste , de Michael Haneke. Je crois
que Gabrielle a commencé à ce moment-là. Puis Haneke m'a dit avoir beaucoup aimé
Intimité, et je me suis découvert quelqu'un avec qui je pouvais parler de cinéma,
moi qui suis un peu isolé dans mon coin.
Nous avons fait Le Temps du loup
ensemble - le film de Michael Haneke dans lequel Isabelle Huppert et Patrice Chéreau
jouaient -. On se tournait autour. Ça a rendu plus aigu le fait qu'on n'avait
jamais travaillé ensemble. En même temps, je suis incapable de penser un projet
uniquement pour une actrice. Jamais ne me suis dit : "Je vais écrire pour Isabelle
Huppert." Il s'est trouvé que le jour où j'ai eu envie d'adapter la nouvelle,
j'ai pensé à Pascal et à Isabelle."
Il déclare encore:
Q: Avez-vous
pensé, en choisissant la nouvelle de Conrad, que c'était l'image inversée d'Intimité
?
Non, j'ai reçu cette nouvelle de plein fouet. Cette référence inversée,
je l'ai comprise au montage. Un réalisateur pense toujours qu'il fait un truc
totalement différent de ce qui précède. Après, on découvre qu'on n'est pas capable
de faire autre chose que ce qu'on a déjà fait. Haine ou fièvre charnelle, on n'échappe
pas à la violence.
Q C'est
votre vision du couple ?
J'ai une conception pessimiste, fataliste en tout
cas, des rapports de couple, quel que soit le sexe des partenaires. Le couple
est une chose à construire tous les jours sans aucune garantie de durée. C'est
vrai que j'aborde ce thème avec constance depuis quatre films. C'est une question
qui me taraude. Je me demande pourquoi ces gens vivent si mal.
Manderlay, scénario et réalisation
de Lars
von Trier, avec : Bryce Dallas Howard (Grace), Timothy
(Isaach De Bankolé), Danny Glover (Wilhelm), Willem Dafoe (le père de Grace),
durée 139 mn, sortie publique le 9 novembre 2005.
Voir
fiche complète
Ce film est la suite de Dogville (2003), tournée avec la même idée d'un plateau au décor minimal. C'est le deuxième épisode de la trilogie USA - Land of opportunity.
| Grace est partie de Dogville avec son père
et son équipe de gangsters. Ils traversent les États-Unis mais sont arrêtés devant
la plantation par une femme noire qui demande de l'aide car un de ses compagnons
va recevoir des coups de fouets. Pour faire comprendre à tous comment ils devraient
vivre, elle décide de faire inverser les rôles. Les Noirs seront désormais les
propriétaires et les Blancs les esclaves. Mais, les anciens esclaves gardent leurs
nombreuses anciennes habitudes et se mettent au travail difficilement. Les futures récoltes sont en partie remises en cause et les deux tiers des réserves de nourriture sont dévastés. La famine fait alors rage. Grace, pendant ce temps, commence à développer des fantasmes sexuels envers les garçons noirs et vigoureux et, en particulier, Timothy considéré comme un Proud Niger, un Munsi. La récolte vient enfin, le coton est très blanc et ils en tirent un bon prix. L'argent est ramené à la plantation et Grace décide alors de laisser les gangsters partir. Elle estime que tout le monde a compris. |  |
Lors du dîner qui s'ensuit, elle cède aux charmes de Timothy qu'elle désirait depuis longtemps. Mais, au matin, elle se rend compte qu'une bagarre a éclaté, un Noir a été tué, les Blancs se sont enfuis. Elle apprend que l'argent a été volé. Un joueur professionnel ramène 80% de cet argent qu'il a gagné contre Timothy au poker. C'était donc lui le voleur.
De
plus, elle découvre qu'une grande partie des anciens esclaves avait préféré rester
dans leur ancien état de peur de n'être pas accepté par la société. Elle découvre
même que c'est l'aïeul des esclaves qui a écrit les lois qui réglaient la plantation
"Le livre de Mam".
Les Noirs décident alors de revenir à leur ancien
état et imposent à Grace de remplacer Mam. Grace feint d'accepter pour essayer
de s'enfuir, mais elle fouette tout de même Timothy pour son vol. Elle manque
de peu son père venu la chercher et s'enfuit de nouveau à travers les États-Unis.
Comme dans Dogville, le générique de fin est très signifiant et doit être considéré comme une des explications du film. La place des Noirs dans la société et l'histoire américaine défile sous forme de photos
La mise en scène
minimaliste permet de se concentrer sur le propos et les thèmes, riches
et nombreux, proposés par Lars von trier Nicole Kidman aurait dû continuer
à interpréter le rôle de Grace, mais officiellement pour des raisons d'agenda,
elle n'a pas pu se libérer; remplacée par Bryce Dallas
Howard, plus jeune, le personnage parait pourtant plus mûre.
Contrairement à Dogville où Grace était passive jusqu'à
la fin en forme de "jugement dernier", Grace dispose ici de tous les
pouvoirs et doit donc assumer les conséquences de ses actes.
Mais, à l'étude psychologique sur la cruauté, le pouvoir et les vils instincts s'est substituée une fable proche de la satire nettement plus idéologique autour de la ségrégation, et plus largement des rapports entre dominants et dominés. Les personnages sont plus abstraits, et Grace est moins sujette à une identification possible.
Grace, donc, arrive en libératrice. Au début, ce n'est pas facile : ceux qu'elle veut sauver du joug esclavagiste sont sceptiques, ont peur de s'assumer, de décider par eux-mêmes. Ne voulant rien imposer par la violence, Grace se montre très patiente et pédagogue mais elle possède la force et peut y recourir à tout moment, via ses hommes de main.
La communauté commence à prendre son destin en main et s'organise en système quasi
autogéré. La démocratie directe y est pratiquée, avec plus ou moins
de bonheur. Ainsi le réalisateur pointe les limites du processus de vote
à deux moments clés.
Le premier, quand il s'agit de déterminer
par un vote l'heure exacte. Ce point mineur aura des conséquences troublantes
à la fin du film. Les sciences exactes n'obéissent pas aux lois
de la majorité.
La deuxième limite dénoncée par
Lars von trier est la décision démocratique d'une peine de mort
au sein de la communauté. Ce n'est pas parce que l'opinion publique d'un
pays est majoritairement pour ce châtiment suprême^me que les gouvernants
doivent d'appliquer.
Lars von trier prend un plaisir évident à retourner comme une crêpe le politiquement correct, en premier lieu celui qui touche au statut des Noirs, souvent réduits à être soit des révoltés soit des victimes, jamais des coupables. Un statut que les intéressés eux-mêmes n'hésitent pas à reproduire, drapés dans une intégrité stérile, confortable. Personne ne sort disculpé de cette déroute cuisante, et surtout pas les Blancs. En Grace, missionnaire démocrate au grand cœur, on peut aussi voir le pire visage de la bonne conscience et de l'humanisme sûr de son fait, de ses convictions.
Lars von trier qu'on a parfois considéré comme cinéaste chrétien obsédé par la rédemption se montre ici cinglant sur le pouvoir tyrannique de la bonté, qui masque toujours quelque chose de pas clair, de suspect. Que ce film plus cynique qu'ambigu ait provoqué une polémique aux États-Unis dit assez bien les dégâts collatéraux provoqués aujourd'hui par le politiquement correct. Montrer que la « victimisation » généralisée masque souvent un refus de prendre ses responsabilités, que la ségrégation raciale persiste sous une forme déguisée aux États-Unis ou ailleurs, cela témoigne d'un regard plus vigilant qu'hérétique. Lars von trier ne fait au fond que mettre en scène cette vérité inquiétante : une démocratie incapable de réfléchir sur elle-même est une démocratie bien malade.
Plus de cinéma . Des remarques! des questions? Venez déposer librement vos réactions sur les pages wikini cinéma de NezumiDumousseau