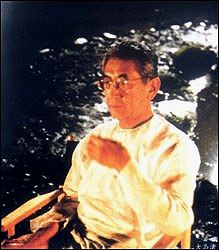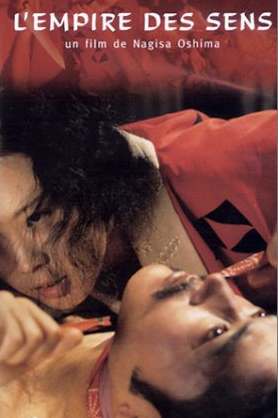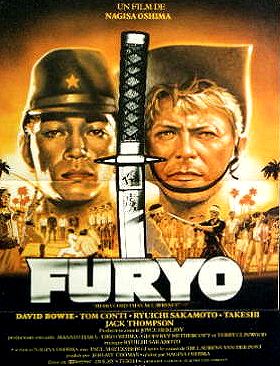|
 Nagisa
Ôshima Nagisa
Ôshima
渚 大島 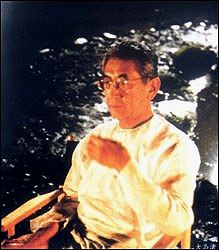
cinéaste japonais
Kyoto, 31/3/1932 - Tokyo, 15/1/2013
|
Biographie
Cinéaste japonais, Nagisa Oshima est né le 3 mars 1932 à Kyoto.
Orphelin de père à l'âge de six ans, il passe sa jeunesse aux
côtés de sa mère et de sa sœur cadette.
Dans sa jeunesse, il détestait sa ville natale Kyoto, qu'il jugeait trop conservatrice
et qu'il aurait voulu voir détruite dans les bombardements
de la Seconde Guerre mondiale.
Après des études de droit, il se lance dans le cinéma. Il entre aux studios
Shochiku. Il y devient assistant réalisateur, notamment avec Yoshitaro Nomura
et Masaki Kobayashi jusqu'en 1959, et signe un premier film Une Ville d'amour
et d'espoir .
Il réalise par la suite Contes cruels de la jeunesse , film au sujet
et au style neuf et énergique qui le désigne comme l'un des chefs de file de
la "nouvelle vague" de la Shochiku, avec Yoshida et Shinoda.
Son film suivant « Nuit et brouillard du Japon » (1960) intitulé ainsi en hommage
au film Nuit et brouillard (1955) d'Alain
Resnais, tourné pratiquement à l'insu de la Shochiku, et traitant d'un sujet
politique brûlant, cause un grand scandale.
|
En 1965, il crée sa propre compagnie indépendante, la Sozo-Sha, avec
l'aide de sa femme, l'actrice Akiko Koyoma. Il tourne alors plusieurs
films, plus ou moins "scandaleux", qui s'attaquent à divers tabous du
Japon moderne, en particulier le sexe et le crime, deux de ses thèmes
récurrents, tout en renouvelant radicalement le langage cinématographique
des films progressistes des années 50 : «Les Plaisirs de la chair», «La
Pendaison», «Il est mort après la guerre», «La Cérémonie», «Une Petite
Soeur pour l'été».
C'est grâce à la collaboration d'un producteur français, Anatole Dauman,
qu'Oshima peut tourner ce qui deviendra son plus grand succès international,
« L'empire des sens » (1976), qui s'appuie sur un fait divers de 1936,
et où il s'attaque délibérément au tabou du sexe et aux censeurs, en filmant
pour la première fois au Japon des actes sexuels non simulés.
Hospitalisé en 2012, il meurt d'une infection pulmonaire dans la banlieue
de Tokyo, à l'hôpital de Fujisawa, le 15 janvier 2013
|
|
Son style, qu'il pousse, au-delà du réalisme, aux extrêmes
de la révolte, du sexe et de la violence, présente des scènes d'une grande beauté
formelle.
Suivent des documentaires pour la télévision «Kyoto, la
ville de ma mère» et «100 ans de cinéma japonais».
Ses collaborations à des productions internationales, Furyo (Merry Christmas,
Mr. Lawrence, 1983), qui réunit David Bowie, la vedette pop japonaise Sakamoto
Ryuichi et Tom Conti, d'après The Seed and the Sower (1963), roman de sir Laurens
Van der Post, ainsi que Max, mon amour (1986), qui traite des relations entre
une femme et un chimpanzé, ont été moins bien accueillies.
Nagisa Oshima demeure sans doute la figure de proue de ladite "nouvelle vague"
au Japon, et le partisan d'une notion exacerbée du cinéma d'auteur.
Filmographie :
- 1959 : le Garçon vendeur de colombes (Ai to kibo no machi « Le Quartier
de l’amour et de l’espoir » )
- 1959 : (Asu no taiya)avec Yuko Mochizuki, Hiroshi Fujikawa
- 1960 : Contes
cruels de la jeunesse (Seishun zankoku monogatari) avec Yusuke
Kawazu, Miyuki Kuwano
- 1960 : L'Enterrement
du soleil (Taiyo no hakaba) avec Junzaburo Ban, Fumio Watanabe
- 1960 : Nuit
et Brouillard au Japon (Nihon no yoru to kiri) avec Miyuki
Kuwano, Fumio Watanabe
- 1961 : Le Piège (Shiiku)
- 1962 : Le Révolté (Amakusa Shiro Tokisada) avec Hashizo Okawa, Takamaru
Sasaki
- 1964 : Le Voyage aventureux d’un gosse , moyen métrage (Chiisana
boken ryoko )
- 1964 : C’est moi Bellett, moyen métrage (Watashi wa Bellett )
- 1965 : Les
Plaisirs de la chair (Etsuraku) avec Katsuko Nakamura, Mariko
Kaga
- 1965 : Le Journal de Yunbogi, court métrage (Yunbogi no nikki)
- 1966 : Violences en plein jour (Hakuchu no torima ) avec Kei Sato, Akiko
Koyama
- 1967 : Carnets secrets des Ninja (Ninja bugeicho) avec Kei Sato, Shoichi
Ozawa
- 1967 : Traité des chansons paillardes japonaises (Nihon shunkako ) avec
Nobuko Miyamoto, Ichiro Araki
- 1967 : Été japonais : double suicide contraint (Muri shinju : Nihon no
natsu)
- 1968 : La Pendaison (Kosheikei) avec Fumio Watanabe, Kei Sato
- 1968 : Le Retour des trois soûlards (Kaettekita yopparai)
- 1968 : La guerre du Pacifique ( Daitoa senso) (TV)
- 1968 : Journal d’un voleur de Shinjuku (Shinjuku dorobo nikki)
avec Tadanori Yokoo, Rie Yokoyama
- 1969 : Le Petit Garçon (Shônen) avec Fumio Watanabe, Tetsuo Abe
- 1969 : Mao-Tse-Tong et la révolution culturelle ( Mo-taku-to to bunka
daikakumei ) (TV)
- 1970 : Il est mort après la guerre (Tokyo senso sengo hiwa) avec Kazuo
Goto, Himiko Iwasaki
- 1971 : La
Cérémonie (Gishiki), avec Kenzo Kawarazaki, Atsuo Nakamura
- 1972 : Une petite sœur pour l’été (Matsu no imôto)
- 1972 : Joi! Bangla (TV)
- 1972 : Kyojin-gun (TV)
- 1975 : La bataille de Tsushima
- 1975 : Ikiteiru nihonkai-kaisen (TV)
- 1976 : Denki mo-taku-to (TV)
- 1976 : Ikiteiru gyokusai no shima (TV)
- 1976 : Ikiteiru umi no bohyo (TV)
- 1976 : Ogon no daichi Bengal (TV)
- 1976 : L’Empire des sens (Ai no korida)
- 1977 : Shisha wa itsumademo wakai (TV)
- 1977 : Yokoi shoichi: guamu-to 28 nen no nazo o ou (TV)
- 1978 : L'Empire de
la passion (Ai no bôrei) avec Tatsuya Fuji, Kazuko Yoshiyuki
- 1983 : Furyo (Senjo no Merry Xmas, Mr Lawrence)
avec David Bowie, Tom Conti
- 1986 : Max, mon amour (Makkusu, mon amûru) avec Anthony Higgins, Charlotte
Rampling
- 1991 : Kyoto’s My Mother’s Place, moyen métrage télévisé
- 1994 : 100 Years of Japanese Cinema (TV)
- 1999 : Tabou
(Gohatto) avec Takeshi Kitano, Shinji Taked
* L'Empire des sens, un film franco-japonais
de Nagisa Oshima, sorti en 1976, titre original : 愛のコリーダ
, Ai no korida ; titre USA: In the Realm of the Senses ; scénario
de Nagisa Oshima , musique de Minoru Miki et chants traditionnels japonais,
images de Hideo Ito ; production : Argos Films, France et Oshima Productions,
Japon ; durée : 105 minutes ; avec Eiko Matsuda ( Sada Abe ) , Tatsuya Fuji
( Kichizo ) , Aoi Nakajima ( Toku ) , Yasuko Matsui( Tagawa Inn Manager ) ,
Meika Seri ( Matsuko ) , Kanae Kobayashi ( Kikuryû ) , Taiji Tonoyama( le vieux
mendiant) , Kyôji Kokonoe ( Omiya ) , Naomi Shiraishi ( Geisha Yaeji )
|
Le film se déroule en 1936 dans les quartiers bourgeois de
Tokyo. Sada, ancienne geisha devenue serveuse de restaurant, aime épier
les ébats amoureux de ses maîtres et soulager de temps à autre les
vieillards vicieux.
Fortement excité par cette fille, son patron, Kichizo, va l'entraîner
dans une escalade érotique qui ne connaîtra bientôt plus de bornes. Leurs
rapports sont épicés par toutes sortes de prestations annexes, qu'ils
accomplissent comme autant de célébrations initiatiques. Au terme d'une
joute épuisante, Kichizo se laissera étrangler par sa compagne, qui l'émasculera
dans un geste ultime de mortification.
Ce film est inspiré d'un fait divers authentique.
Dans le Japon militariste de 1936, un couple défraya la chronique en vivant
une passion charnelle extrême. L'ancienne Geisha Sada Abe et son
amant Kichizo s'entraînèrent chacun dans une spirale érotique qui
les coupa progressivement du monde extérieur. Une folie dictée par les
sens qui se termina par l'arrestation de Sada Abe, retrouvée errant
dans la rue avec le sexe de Kichizo qu'elle avait auparavant mutilé.
Cet hymne à l'amour fou et destructeur réussit la gageure d'échapper à
toute vulgarité.
Tel quel, le film devient un hymne charnel, mais ritualisé à l'extrême,
et ressemblant beaucoup moins à une chronique galante qu'à une espèce
de sacrifice mutuel.
Lors de sa sortie dans les salles japonaises en 1976, L'Empire
des sens provoqua un vrai scandale en raison de son caractère pornographique.
Le film, interrogation sur les limites de l'érotisme bien plus qu'un simple
divertissement osé, fut ainsi censuré dans son pays d'origine : scènes
coupées, zones de flou sur les parties sexuelles. Le réalisateur Nagisa
Oshima ne fut pas épargnée, puisque la pornographie reprochée au film
provoqua un procès durant lequel il dut comparaître. Le Japonais fut relaxé
en 1982.
Voir aussi Fiche
complète
|
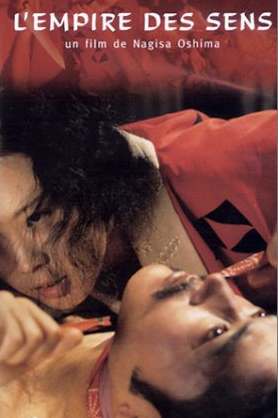 |
Après quelques ennuis, et grâce à la coproduction française,
le film est diffusé dans le monde entier et connait un grand succès.
L'Empire des sens fut présenté à Cannes en 1976, lors de la Quinzaine
des réalisateurs.
A la suite de sa projection au Festival du Film de Berlin, L'Empire
des sens fut accusé de pornographie. Néanmoins, dix-huit mois plus tard,
la Cour Fédérale allemande autorisa la sortie du film dans les salles du pays
sans la moindre censure.
* Furyo , un film anglo-japonais
de Nagisa Oshima, sorti en 1983, scénario de Paul Mayersberg et Nagisa
Oshima d'après la nouvelle A Bar of shadow, extraite du recueil The
Seed and the sower de Laurens Van Der Post; musique de Ryuichi Sakamoto
; durée : 124 minutes
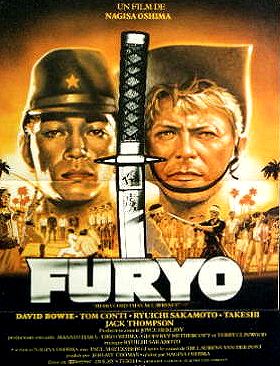 |
Le film se déroule pendant la seconde guerre mondiale, à
Java, dans un camp de prisonniers. Des soldats anglais sont détenus par
des soldats japonais. Le capitaine Yonoï dirige le camp, secondé par le
sergent Gengo Hara .
Le colonel John Lawrence , anglais bilingue, joue l'intermédiaire entre
les japonais et les anglais.
Un premier incident ébranle la routine du camp lorsqu'un garde coréen
ayant eu des relations sexuelles avec un prisonnier hollandais se fait
hara-kiri.
Yonoi suspend la cérémonie funéraire pour assister au procès d'un
officier, le troublant Major Jack Celliers, pour lequel il voue une troublante
passion. Assistant au jugement du Major , le capitaine Yonoï lui permet
d'échapper à la peine de mort et de rester prisonnier au camp. A parti
de là, se nouent des jeux d'oppositions et d'attirances, des histoires
d'amour homosexuelles et d'interdit.
Lawrence représente le personnage qui semble comprendre les
japonais. C'est ce que ceux-ci lui laisse croire jusqu'à ce qu'il ne saisisse
plus leur comportement.
Quand Lawrence va voir Yonoï qui s'entraîne au sabre pour lui demander
d'arrêter son entraînement qui gène les malades , au moment où Lawrence
et Yonoï semblent s'accorder par une discussion sur des souvenirs communs
au Japon, le passé de Yonoï ressurgit avec ses devoirs.
Il prépare aussitôt l'exécution du soldat coréen. Et la rupture s'établit
lorsque, devant l'autel où Hara officie au rite funéraire du soldat qui
s'est suicidé de n'avoir pas pu tuer Celliers, Yonoï expose le jeu de
mort et de vie qui s'établit sur l'ordre du crime à la punition, accusant
Lawrence de l'introduction de la radio dans le camp .
Le tournage s'est déroulé à Rarotonga, dans les îles Cook. Le scénario
est tiré d'une nouvelle de Laurens Van Der Post, auteur britannique
qui fut prisonnier de guerre pendant quatre ans dans un camp japonais.
|
Lawrence est donc le personnage qui possède le plus de compassion envers
les japonais et qui cherche à les rejoindre, si ce n'est dans leur logique,
au moins les retrouver sur un plan humain. Ce que Lawrence n'attend plus se
passe lorsque Hara, saoul, libère Lawrence et Jack et leur souhaite un joyeux
noël. Moment d'échange, quand l'alcool libère des inhibitions.
Mais, là où la relation s'arrête entre le sergent Hara et Lawrence, Celliers
va plus loin dans sa relation avec Yonoï. Si Lawrence s'arrête aux codes de
l'amitié, Celliers dépasse la raison pour accéder à l'amour.
Apogée de la relation ambigu entre Celliers et Yonoï, lorsque le capitaine
va trancher la tête de l'officier qui dirige le groupe d'évadés
anglais, Jack s'avance vers Yonoï dans un instant où le temps semble s'être
arrêté. Il l'agrippe et l'embrasse sur les deux joues. Images saccadées, mouvement
fraternel et plus, message d'adieu et d'amour. A partir de là, le film rassemble
les pardons des personnages qui gravitent autour de Jack. Il retrouve son frère
en rêve qui l'excuse. Yonoï revient de nuit chercher une touffe de cheveux pour
le commérer sur son autel. Tout un processus respectueux, où chaque personnage
appose ses mouvements dans un temps d'observation de l'autre.
La fin du film se place quatre ans plus tard. La guerre est finie et Lawrence
rend visite au sergent Hara en prison, toujours à Java. Ici, les rôles
s'inversent, et la compassion de Lawrence n'a fait qu'augmenter.
Oshima a fait des choix surprenants mais très efficace pour ses acteurs.
Lawrence est interprété par Tom Conti, un acteur de théâtre qui a notamment
joué dans Les Duellistes de Ridley Scott.
Hara, personnage à la fois jovial et cruel, qui symbolise le peuple, par Takeshi
Kitano, aujourd'hui acteur et réalisateur bien connu, mais à l'époque comique
populaire seulement au Japon.
Yonoï est un samouraï. Pour l'incarner, Oshima a choisi Ryuichi Sakamoto, du
Yellow Magic Ochestra, qui débute au cinéma. Il est aussi l'auteur de la magnifique
et hiératique bande-son , que Bowie a refusé de composer pour pouvoir être totalement
crédible en tant qu'acteur.
Bowie, depuis toujours fasciné par le Japon, donne donc la réplique à une sorte
d'alter ego nippon. Bowie et Sakamoto, deux visages, l'un occidental, l'autre
oriental, d'une même identité artitisque, celle de la scène pop, jointe à une
même singularité, celle d'une recherche visuelle menée en parallèle d'une recherche
musicale.