Smoking / No Smoking, film français d' Alain ResnaisSmoking / No Smoking d'Alain Resnais, scénario d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, d'après la pièce Intimate Exchanges d'Alan Ayckbourn |

|
Analyse
Un village du Yorkshire. Celia Teasdale, femme du directeur de l’école, fait le ménage de printemps dans son cottage. Lors d’une pause, sur la terrasse, elle hésite. puis prend une cigarette. Arrive alors Lionel Hepplewick, le gardien de l’école, qui doit s’occuper du jardin. Conversation, confidences, désarroi de Celia : son mari, Toby, l’aime de moins en moins, boit et risque sa place. Lionel lui dit qu’elle ne le laisse pas indifférent. Celia rentre dans la maison. Sylvie, la bonne, intervient et tente sans succès d’intéresser Lionel. «Cinq jours plus tard», le jardinier, amoureux de Celia, voudrait devenir boulanger et fait des projets avec elle. «Cinq semaines plus tard», lors d’une fête, Miles Coombes, ami de Toby et soupirant de Celia, s’étonne que la jeune femme veuille s’associer avec l’aspirant-boulanger, déjà incapable de réussir le pain et les gâteaux du jour, ce qui rend Celia hystérique. «Cinq ans plus tard», on enterre le père de Lionel. Celia émerge d’une longue dépression, revoit son ex et bref associé, marié maintenant à Sylvie et à la tête d’une entreprise prospère.
«Ou bien», «ou bien».
L’association Celia-Lionel aurait pu fonctionner : elle commanderait, il obéirait. Le mari boirait toujours, Miles et sa femme seraient partis en Australie. À moins que Celia, réconciliée avec son mari et en vacances avec lui, ait revu Lionel, serveur dans un hôtel sinistre : il la gaverait de gâteaux comme preuve d’amour. Plus tard, on enterrerait Toby, cette fois. Dans le rôle du fossoyeur, Lionel !. Bien avant, Sylvie aurait pu retenir l’attention de Toby. Il ferait son éducation. Sylvie épouserait pourtant le jardinier. Toby irait vivre à Londres avec Miles. À moins que Sylvie quitte tout et revienne des années plus tard, journaliste connue, femme indépendante, pour rencontrer Toby, lui suggérer sa reconnaissance et sa nostalgie.
No Smoking
Un village du Yorkshire. Celia Teasdale, femme du directeur de l’école, fait le ménage dans son cottage. Sur la terrasse, lors d’une pause, elle hésite à prendre une cigarette. et s’abstient. Entre Miles Coombes, ami de son mari Toby, gêné d’évoquer l’ivrognerie de ce dernier et ses carences sentimentales et professionnelles. «Cinq jours plus tard», Celia et Miles dînent en tête-à-tête forcé — Toby et Rowena, femme de Miles, ayant omis de venir. Ils évoquent leurs malchances respectives puisque Rowena a des amants. Miles avoue intervenir de la part de Toby auprès de Celia pour les réconcilier, et pourtant il courtise la jeune femme. Quand Toby rentre enfin, Miles se cache dans la remise du jardin. Le malentendu est à son comble. «Cinq semaines plus tard», au golf, Miles et Celia, puis Celia et Toby, puis Toby et Rowena, enfin Rowena et Miles vident leurs rancœurs mais en restent au statu-quo. «Cinq ans plus tard», Toby est mort; près de sa tombe, de retour d’Australie où il vit avec sa femme, Miles revoit Celia. Nostalgie.
«Ou bien», «ou bien».
Au golf, la rupture Miles-Rowena serait consommée. Plus tard, près de la chapelle, Celia reverrait Miles, qui vivrait maintenant avec Toby. À moins que, après une dispute avec Rowena, Miles, excédé, cloîtré dans la remise, nourri par Celia, ait confié à Sylvie son espoir de partir avec elle faire le tour du pays à pied. Toby serait las de cette comédie et Lionel, le jardinier, soupirant de Sylvie, délogerait l’intrus en enfumant les lieux. Plus tard, près de la chapelle enneigée, Sylvie, mariée à Lionel, puis Celia reverraient avec regret Miles, séparé de Rowena. À moins que Miles et Rowena se soient réconciliés. Ou que Sylvie et Miles aient vécu une idylle mouvementée et sportive, perdus dans la brume. Miles, ensuite, pourrait être témoin du mariage de Sylvie et de Lionel. Ou Miles aurait pu mourir accidentellement pendant ses brumeuses vacances. Tous se retrouveraient au cimetière, sur sa tombe. Toutes, plutôt : successivement Rowena, Sylvie et même Celia.
A la fois exercice de style rigoureux dans sa construction et fantaisie, ces deux films réunis sont un exemple typique de " film multiple " de Resnais proposant chacun 6 fins différentes à un début commun. Les décors sont volontairement non réalistes, pour rappeler l'origine théâtrale du scénario, et sont toujours situé à l'extérieur, mais tourné en studio.
Smoking/No smoking ressemble à ces « livres dont vous êtes le héros » dans lesquels le lecteur est invité à se rendre à une page différente selon la décision qu'ils feront prendre au protagoniste, ou encore à Cent mille milliards de poèmes, livre animé de poésie combinatoire de Raymond Queneau, publié en 1961.L'objet-livre de Queneau offre au lecteur un instrument qui lui permet de combiner des vers de façon à composer des poèmes respectant la forme du sonnet : deux quatrains suivis de deux tercets, soit quatorze vers. A la différence majeure qu'ici c'est le livre qui tourne ses propres pages et qui choisit l'ordre dans lequel nous les lirons. Le seul choix que le spectateur puisse faire est celui de regarder d'abord l'un ou l'autre, comme l'illustrait l'amusante bande-annonce du film dans laquelle Azéma et Arditi se disputaient pour savoir lequel de Smoking ou No smoking ils iraient voir en premier. En ce sens, le DVD du film est peut-être la manière idéale de le voir, avec son chapitrage qui permet de choisir quelle branche de cette arborescence de destins on désire voir et dans quel ordre. Tel quel, le film semble adopter une certaine « résignation », s'achevant immanquablement dans un cimetière. Ce n'est pas la conclusion de toutes les branches du récit, mais c'est bien celle de chacun des deux films, choix forcément signifiant.
L'exploration des différentes trajectoires possibles des personnages apparaît alors non pas comme une variation sur le libre-arbitre (« ou bien... ou bien », au fond, ce pourrait être une histoire de choix) mais bien au contraire comme une sorte de tragédie où aucun destin ne vient véritablement sauver l'autre, où tous mènent à l'impasse, où aucun échappatoire n'est possible. Smoking/No smoking décrit les existences mesquines et futiles de gens banals et ennuyeux, et leur concocte des destins pour le moins insatisfaisants. Le film n'en finit pas d'assumer ses origines théâtrales, en usant notamment des clichés narratifs et formels du vaudeville, amants dans la remise, femmes insatisfaites et maris alcooliques. Mais, plus profondément, il révèle aussi que toutes nos actions peuvent être lues sous deux lumières radicalement différentes : dérisoires ou sublimes, futiles ou profondes. La lâcheté de Miles n'est-elle pas aussi une résignation admirable ? La méchanceté de Toby ne pourrait-elle pas être plutôt une formidable lucidité ? Resnais et Ayckbourn donnent à voir les abîmes qui guettent nos gestes les plus anodins, et les nuances minuscules qui séparent le bonheur du malheur, une vie ratée d'une vie réussie.
Chaque trajet est une occasion pour le personnage de réaliser un désir
que le précédent trajet ne leur avait pas permis d'accomplir. Les êtres
qui se voient offrir plusieurs destinées sont des êtres ordinaires avec
des problèmes ordinaires, des histoires d'amour mal fichues, plutôt mal
que bien résolues par l'alcool chez l'un par la nymphomanie chez l'autre,
l'apparente résignation chez un troisième. Ils se cherchent sans vraiment
vouloir trouver l'autre, se croisent sans vraiment se voir ; la scène
de la falaise dans le brouillard résume assez bien leur façon d'être ensemble.
C'est une réflexion sur le destin, la place du hasard, mais aussi sur
l'inutilité des regrets, à travers des personnages ordinaires, mais typés,
du loufoque au sinistre, en passant par le raisonnable. Chacun des 5 personnages
féminins sont joués par Sabine Azéma et les 4 masculins par Pierre Arditi,
les personnages secondaires sont évoqués, entendus même, mais jamais vu.
Le maquillage et les accessoires sont d'autant plus appuyés que le personnage
s'éloigne de la norme.
Structure du film
Il est inspiré par huit pièces d'Alan Ayckbourn, créées en 1982 et ayant chacune deux fins, ce qui fait seize possibilités. Chacun des deux films présente six fins, soit douze en tout. Resnais a allégé l'ensemble tout en introduisant une dissymétrie puisque certains " noeuds" du schéma ne se divisent pas en deux.
De plus le déroulement du film parcourt ce schéma dans un ordre fixé par le réalisateur et introduit une hiérachie dans les fins puisque les séquences situées à la fin de chaque film marquent plus le spectateur que les fins "intermédiaires"
Nous ne sommes pas en présence d'une arborescence que l'on parcourt au hasard et à sa guise, mais bien devant un choix délibéré de l'auteur du film.

Le schéma complet de Smoking ../.. No smoking
Agnès Jaoui déclare:
« Pour Smoking/No smoking Alain Resnais était venu à la Bastille
où Jean-Pierre Bacri et moi habitions, à l’époque. Il très timide, très
doux. Il nous avait apporté les pièces d’Alan Ayckbourn, nous avait présenté
le projet. On était ébahis par sa gentillesse et aussi par la folie du
projet, je n’arrêtais pas de me dire que si cela n’avait pas été Resnais,
cela aurait été la proposition d’un fou ! Il avait vu Cuisine et dépendances
et Pierre Arditi lui avait parlé de nous : « Je pense que ce sont des
auteurs qui peuvent vous plaire ». Je crois même que Sabine Azéma était
venue acheter le texte au Théâtre la Bruyère.
Ses films avaient été des chocs pour nous. Je me souvenais précisément
d’avoir vu Muriel, petite. Je me souviens d’un film qui ne ressemblait
à aucun autre, c’était L’année dernière à Marienbad. Pas des films
qu’on avait l’habitude de voir….
Après Smoking / No smoking, on était un peu frustrés, Jean-Pierre et moi. On avait écrit avec joie, on avait vu le film avec joie, mais c’est comme si on n’avait pas entièrement participé à la fête. C’est là qu’on s’est rendus compte qu’on était « des acteurs qui écrivaient », plus que des auteurs au sens strict du terme. Quand il nous a proposé de réécrire un film pour lui, on a accepté, toujours avec joie, mais en ajoutant qu’on aimerait bien jouer dedans. Il a dit oui.
Alain Resnais était considéré ccmme un auteur sérieux avec un côté un peu hermétique, élitiste, or il aimait des choses extrêmement populaires, il n’avait pas de snobisme, ses goûts étaient extrêmement éclectiques, y compris dans le choix de ses acteurs. C’était un artiste, j’ai du mal à trouver un autre mot. Pour Smoking / No smoking, il nous avait mis en garde à plusieurs reprises : « Ça, je l’ai déjà fait dans Mélo, ça dans un autre film, je ne veux pas le refaire ». Ce qui le motivait, c’était d’inventer toujours. »
Distribution
- Pierre Arditi : Toby Teasdale / Miles Coombes / Lionel Hepplewick / Joe Hepplewick
- Sabine Azéma : Celia Teasdale / Sylvie Bell / Irene Pridworthy / Rowena Coombes / Josephine Hamilton

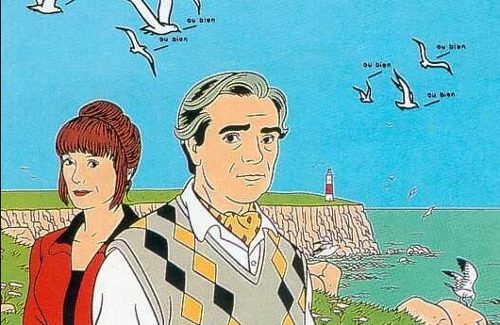
Fiche technique
- Réalisateur: Alain Resnais
- Scénario et dialogues : Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, d'après la pièce Intimate Exchanges d'Alan Ayckbourn
- Photographie : Renato Berta
- Son : Bernard Bats
- Décors : Jacques Saulnier
- Musique : John Pattison
- Montage : Albert Jurgenson
- Dessins de Floc'h
- Production déléguée : Bruno Pesery
- Sociétés de production : Suisse : Vega Film AG / France : Arena Films, Caméra One, France 2 Cinéma, Canal+ / Italie : Alia Films, Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica
- Durée : 140 minutes (2h20)/ 145 minutes (2h25)
- Date de sortie : 15 décembre 1993
- Récompenses:
- César du meilleur film
- César du meilleur réalisateur - Alain Resnais
- César du meilleur scénario original ou adaptation - Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui
- César du meilleur acteur - Pierre Arditi
- 5 autres nominations aux Césars de la meilleure actrice - Sabine Azéma; meilleur décor - Jacques Saulnier ; meilleure photographie - Renato Berta; meilleur son - Bernard Bats et Gérard Lamps ; meilleur montage - Albert Jurgenson
Alan Ayckbourn
Sir Alan Ayckbourn est un dramaturge et metteur en scène britannique né le 12 avril 1939 à Londres, d'un père violoniste et d'une mère romancière. À l'âge de 8 ans, il est marqué par la séparation de ses parents : sa mère épousera l'année suivante un directeur de banque.
Le thème du couple et de la séparation est au centre de son œuvre. À
18 ans, après obtention brillante d'un baccalauréat littéraire, il décide
de devenir un homme de théâtre "total" : électricien, assistant régisseur,
technicien du son, apprenti comédien.
À 20 ans, il se marie avec l'actrice Christine Roland, dont il a deux
fils Steven et Philip. C'est également depuis 1959 que ces pièces sont
créées au Stephen Joseph Theatre de Scarborough, dont il est le directeur
artistique, pour être testées l'été avant d'être jouées l'hiver au West
End Theatre de Londres ou au Royal National Theatre. En 1997 il est anobli
par la Reine Elizabeth II "pour services rendus au théâtre".
C'est cette année-là, également, qu'il divorce de Christine Roland pour
épouser Heather Stoney.
Pièces d'Alan Ayckbourn (liste partielle)
- 1965- Pantoufle (Relatively speaking), adaptation d'Eric Kahane et Jean-Laurent Cochet
- 1969- Les Uns chez les autres (How the other half loves) - adaptation française de Francis Veber et Jean-Laurent Cochet
- 1973- The Norman Conquests
- 1974- Mariages et conséquences (Absent friends) - adaptation de Claire Nadeau 1975- 3 lits pour 8 (Bedroom farce)
- 1976- Entre nous soit dit (Just between ourselves) - adaptation d'Attica Guedj et Stephan Meldegg
- 1982- Intimate exchanges
- 1988- Pièce Détachée (Henceforeward)
- 1992- 1 table pour 6 (Time of my life) - adaptation de Gérard Lauzier
- 1994- Temps variable en soirée (Communicating doors) - adaptation de Michel Blanc
- 1997- L'amour est enfant de salaud (Things we do for love) - adaptation de Michel Blanc
- 1999- House & Garden
- 2003- Sugar Daddies
- 2004- Petites peurs partagées (Private fears in public places)
Films tirés de l'œuvre d'Alan Ayckbourn
- 1989 : Fantômes sur l'oreiller (TV) de Pierre Mondy
- 1993 : Smoking ../.. No Smoking, d'Alain Resnais, d'après Intimate Exchanges
- 2006 : Cœurs, d'Alain Resnais, d'après Petites peurs partagées
- 2014 : Aimer, boire et chanter d'Alain Resnais d'après Life of Riley